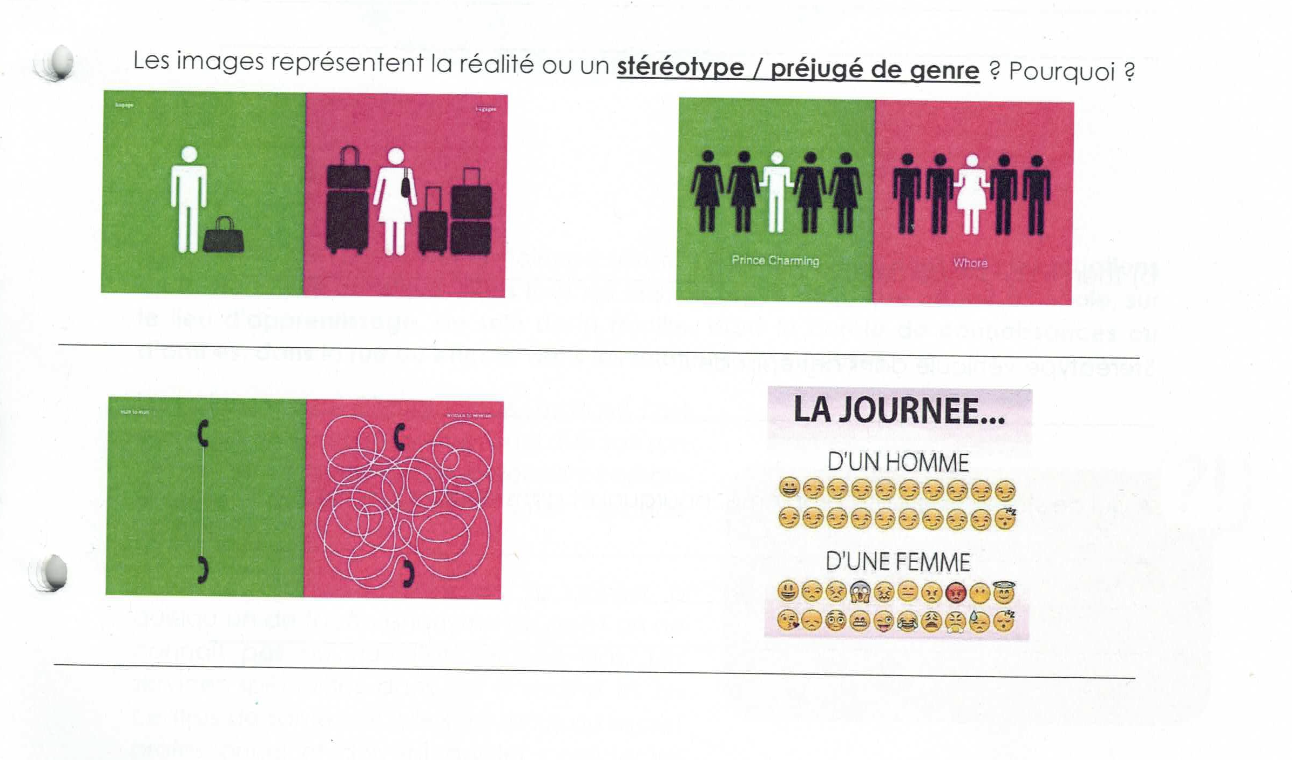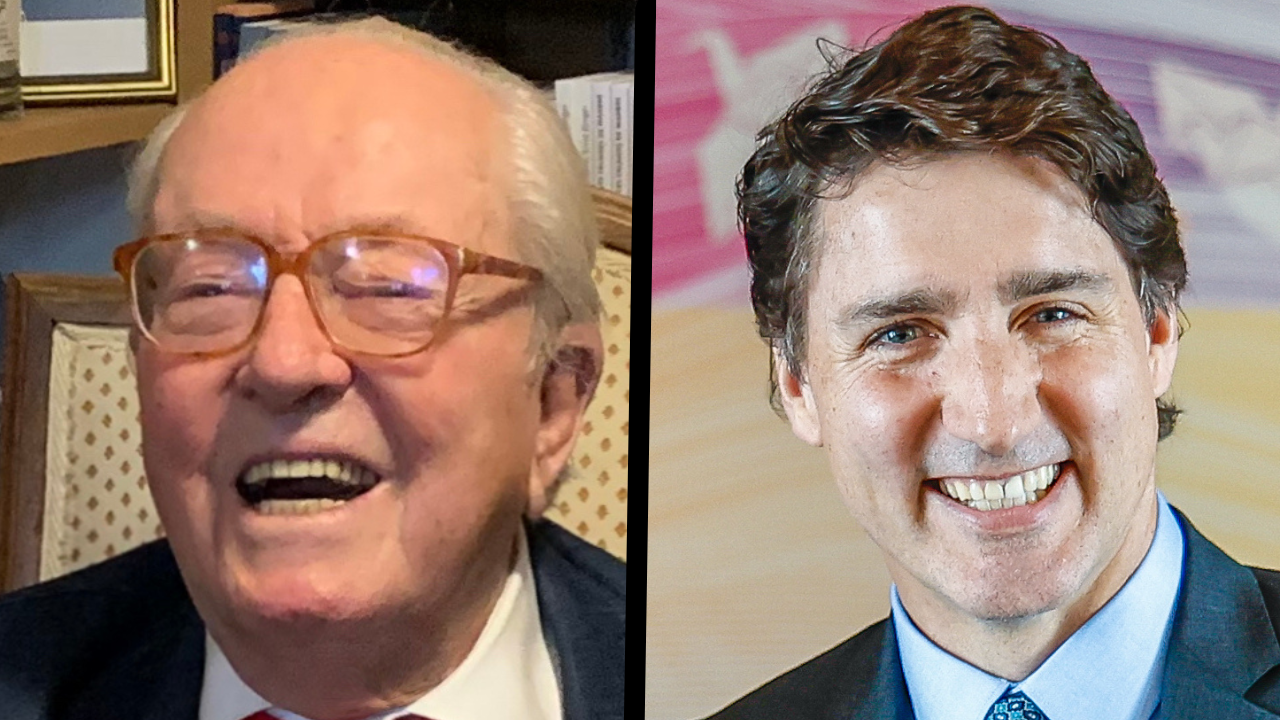Du wokisme de droite appliqué au domaine du sushi
À l’été 2022, un groupe de reggae formé de Blancs faisait la une des médias suisses, et même internationaux. Non à cause de ses idées – tolérantes, inclusives et multiculturelles comme il se doit – mais en raison de la couleur de peau des musiciens et des dreadlocks de l’un de leurs membres. En représentation dans un haut lieu de la culture alternative bernoise, la Brasserie Lorraine, la formation avait été interrompue à l’entracte par des personnes se disant troublées par une supposée appropriation culturelle. Le groupe, devenu le symbole d’une des pires dérives du « wokisme », n’existe aujourd’hui…