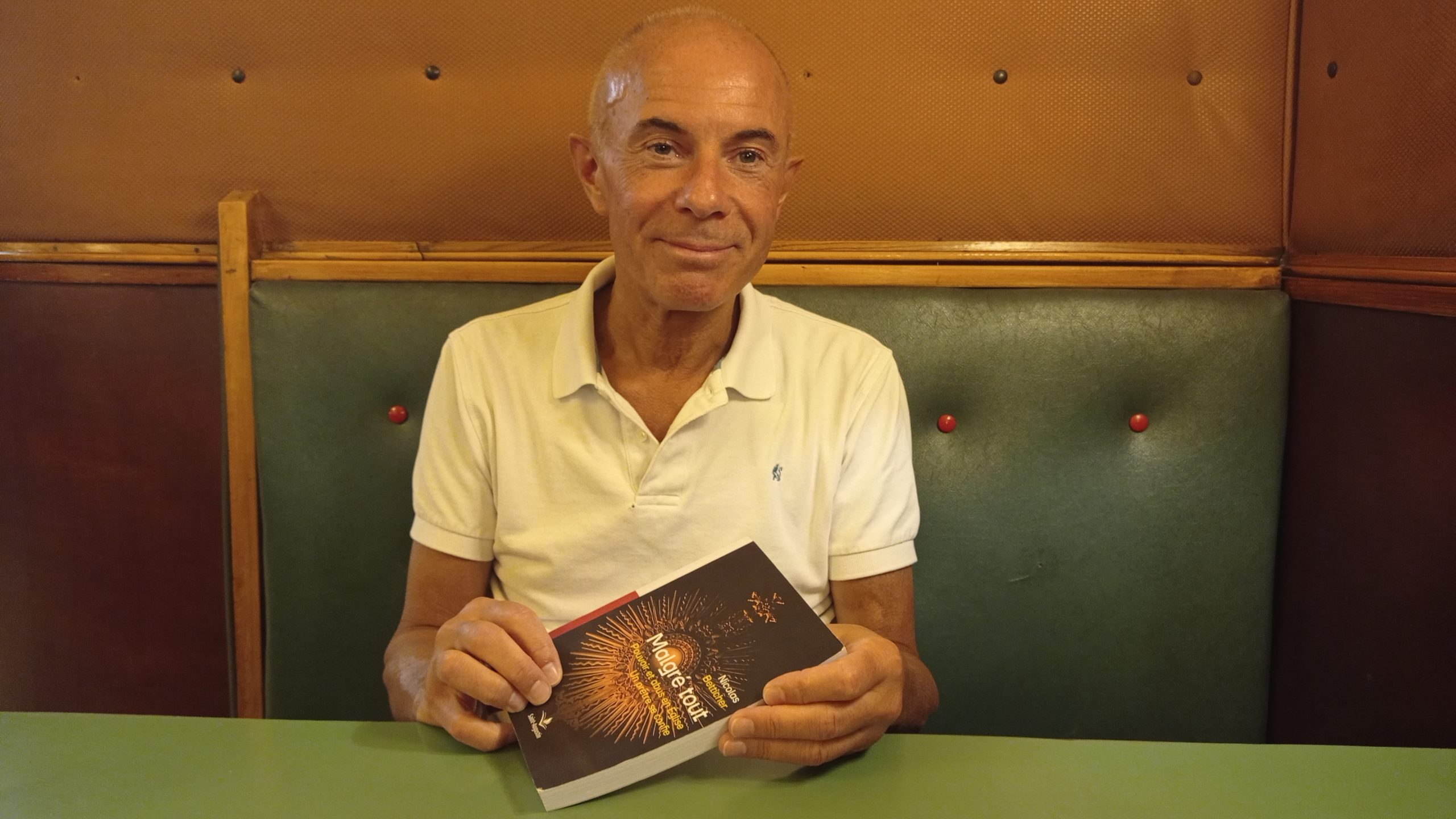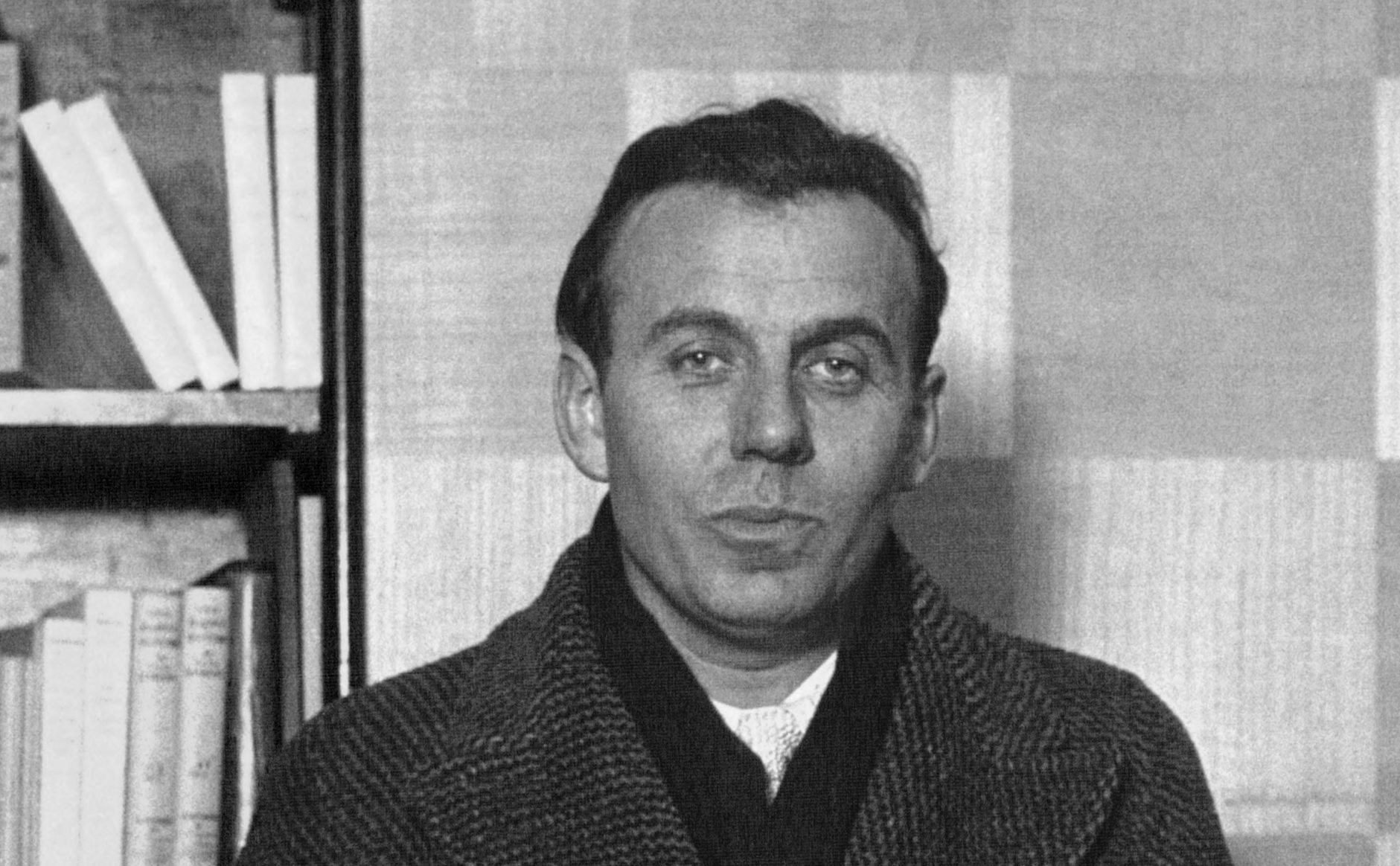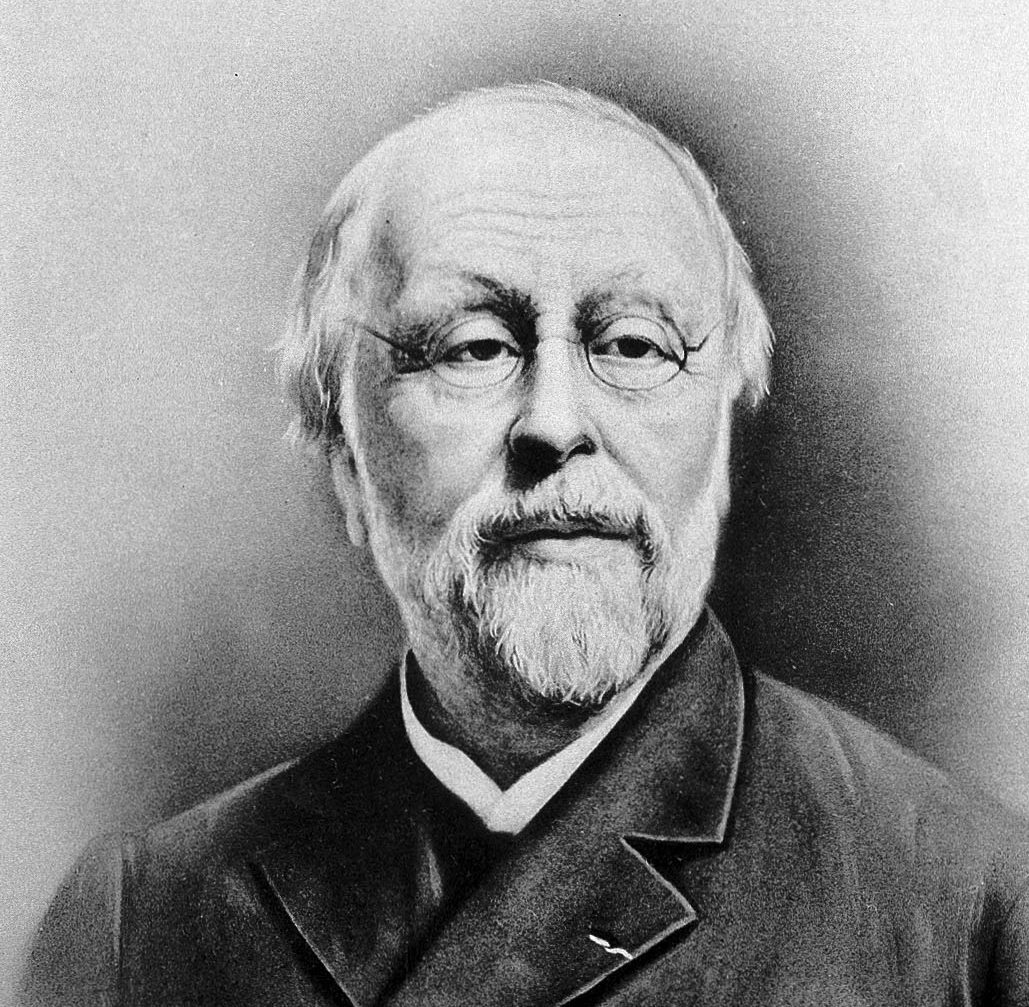Trop blancs pour chanter
I l était une fois un concert de reggae organisé dans un lieu alternatif de la capitale. Plutôt: il était une fois un concert de reggae interrompu par ses propres organisateurs, la Brasserie Lorraine, à Berne. Motif? Les musiciens sont blancs! Pire, ils osent arborer des dreadlocks, sur leurs têtes de blancs. Ne riez pas, les tenanciers du lieu ont plié sous la pression d’un petit comité qui s’est senti «mal à l’aise» (unwohl en allemand), invoquant l’«appropriation culturelle» par le groupe qui devait se produire lors de la soirée du 18 juillet. Lavant plus blanc que blanc, la Brasserie…