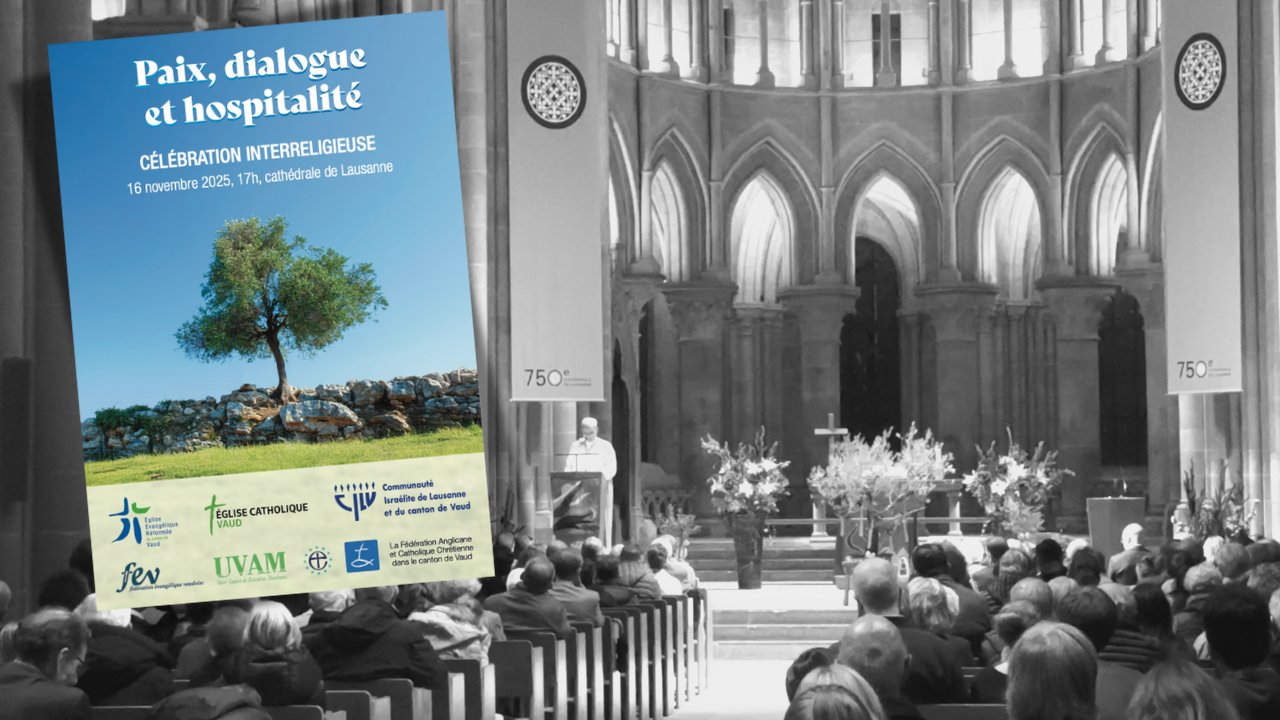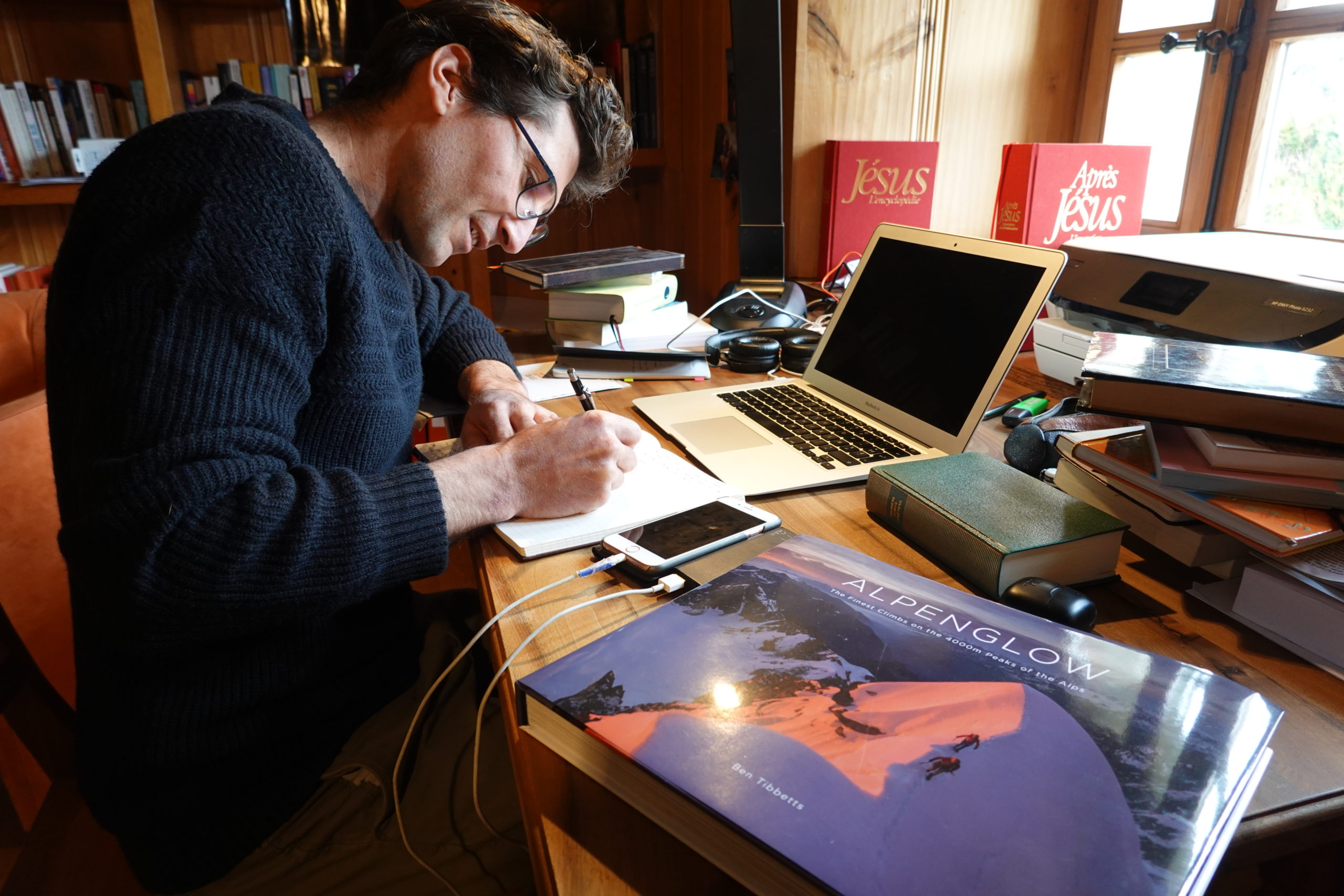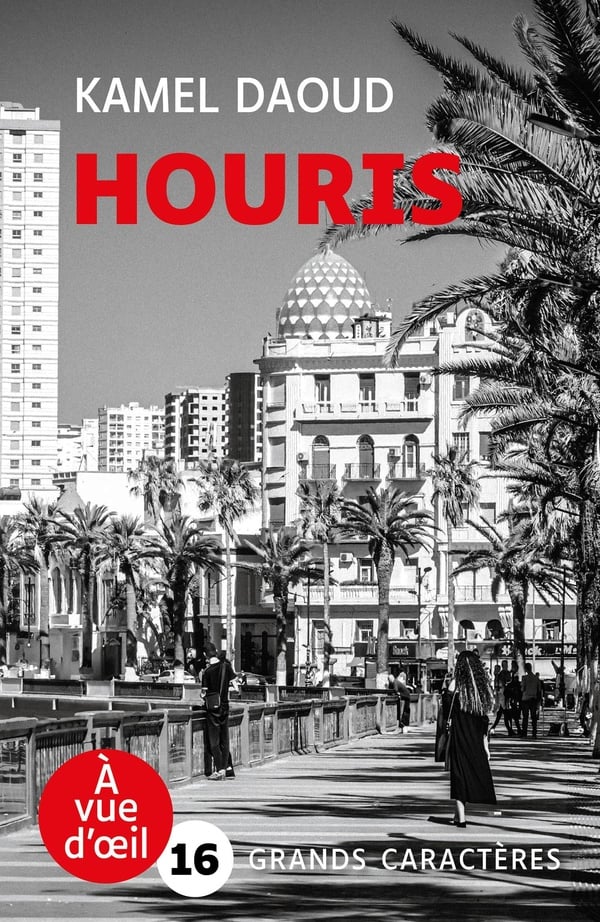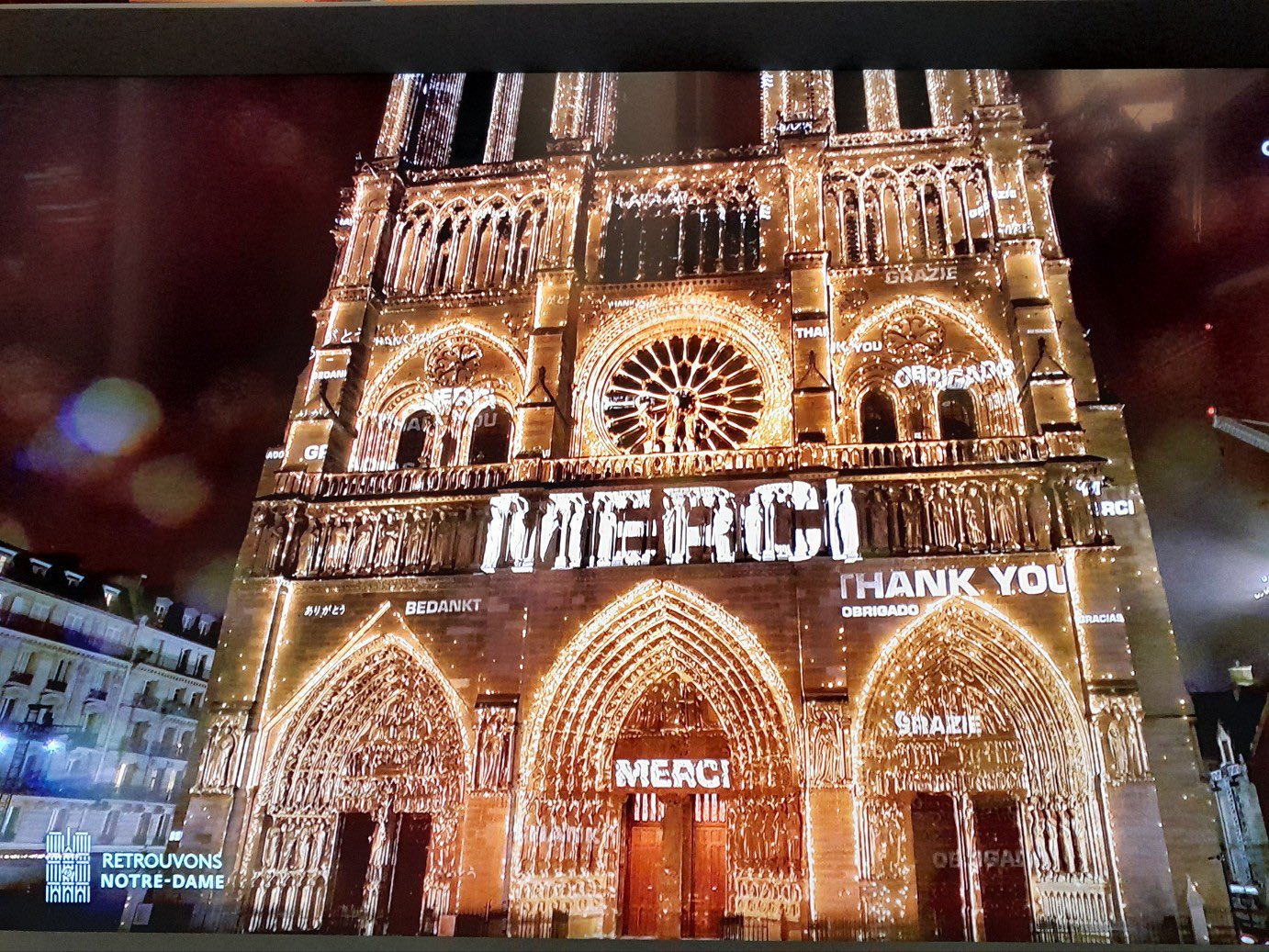La grossesse est-elle une maladie ? Autopsie d’une dérive idéologique en bioéthique
Deux philosophes ont publié un article dans le Journal of Medical Ethics. Leur démarche est de se demander si la grossesse constitue une maladie. Nous n’allons pas ici installer de suspense inutile, leur réponse est OUI. À tous ceux qui sont choqués par cette conclusion qui concerne pourtant un processus naturel – l’objet de cet article est justement d’y apporter un autre éclairage. Pourquoi considère-t-on que la grossesse puisse être une maladie ? En raison des caractéristiques qui y sont associées, telles que les douleurs, les nausées, les vomissements, l’hypertension, sans oublier la perte des capacités physique et le risque de décès…