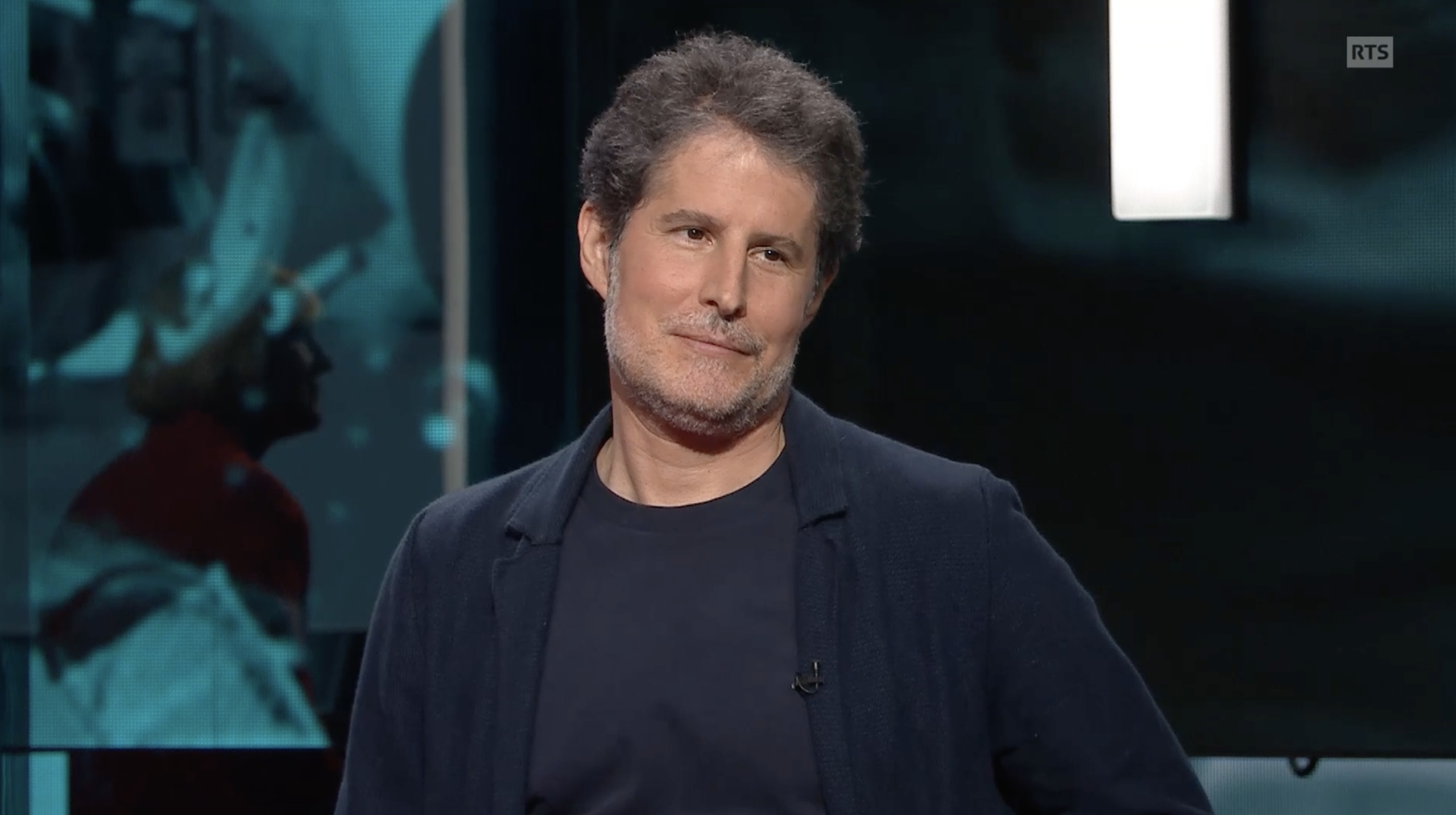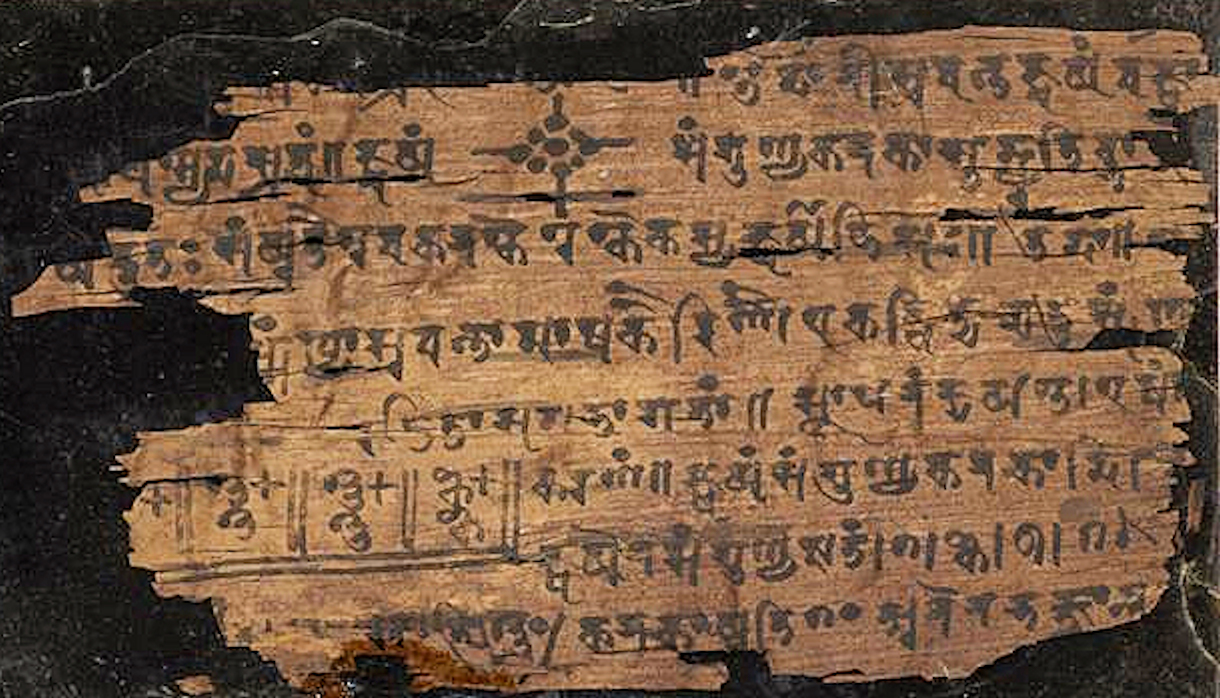A-t-on lu Gramsci ?
J’ai croisé une femme politique, qui selon la presse de gauche – laquelle faisait toujours montre d’une étrange complaisance à son égard -, était une féministe d’extrême droite. Féministe, certes. D’extrême droite, il eût d’abord fallu qu’elle fût de droite. Elle avait une réponse toute faite lorsqu’un militant se plaignait d’une avanie subie de son fait : « J’ai appris que vous dites du mal de moi. » Comme si elle avait été au-dessus de toute critique. Mais surtout moyen efficace de noyer le poisson et de ne pas s’excuser. Pour qui était témoin ou victime de ces méthodes, cela ressortait surtout de…