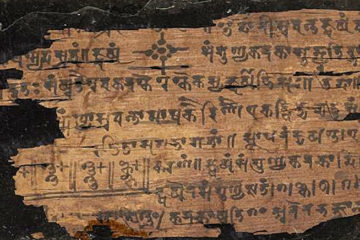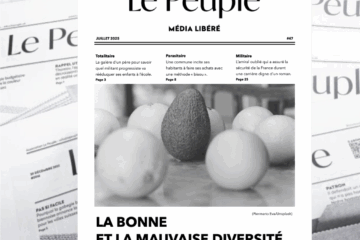Pour reprendre le périple de notre auteur depuis le début, cliquez ici.
Avant de quitter Alger nous montons à la basilique Notre-Dame d’Afrique. Surplombant la ville et lui faisant face, elle domine la mer chargée de bateaux en attente. La situation est unique, et les familles algériennes viennent se retrouver sur l’esplanade.

Terminée en 1872, elle a été construite dans le style romano-byzantin. L’intérieur est lumineux. Le regard, distrait par les fresques et décorations multiples, ne distingue pas tout de suite l’inscription dans le chœur : « Notre Dame d’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans ». En-dessous et sur les murs des bas-côtés, des ex-voto par milliers, dont plusieurs de Charles de Foucauld lui-même. Les chapelles latérales sont dédiées à Saint Augustin et à sa mère Sainte Monique. Considérée comme la sœur jumelle de la basilique marseillaise Notre-Dame-de-la-Gardequi lui fait face de l’autre côté de la Méditerranée, Notre-Dame d’Afrique pointe symboliquement son abside vers le désert. Sur le parvis, une statue de Mgr Lavigerie rappelle qu’il a fondé la Société des missionnaires d’Afrique en 1868. Aujourd’hui, lesdits « Pères blancs » sont principalement africains, tout comme les sœurs qui tiennent la boutique à l’entrée.
Entre méharée et pèlerinage
Puis c’est le départ pour Tamanrasset, au sud du pays. 2000 kilomètres en 2h15 de vol. Et dire qu’entre les deux ermitages de Beni Abbès et Tamanrasset, il y a 1400 km… Et que Charles de Foucauld a parcouru régulièrement cette distance les dernières années de sa vie, soucieux qu’il était d’assurer une présence partout. 1400 kilomètres dans le désert, un voyage d’un mois à pied et à dos de dromadaire, à raison de 50 kilomètres par jour … Une odyssée répétée qui l’a transformé à chaque pas. On réalise petit à petit qui était le personnage. « Il n’y a qu’une certaine race d’hommes qui puisse songer à se retirer au désert pour toujours », a écrit Camus de la côte…
Petite pause dans notre récit: Cet article vous est intégralement offert par amour du beau.
Mais nous avons besoin de vous pour continuer à jouer notre rôle d’empêcheur de penser en rond.
Abonnements : https://lepeuple.ch/sabonner/
Dons: https://lepeuple.ch/nous-soutenir/
Aujourd’hui, Tamanrasset compte 100’000 habitants. A six kilomètres de l’aéroport, l’entrée en ville se fait à travers un de ces arcs communs aux agglomérations sahariennes : « La ville de Tamanrasset vous souhaite la bienvenue », est-il écrit en français et en arabe, mais pas en tamasheq, langue des Touareg. L’arabisation de la région est un sujet sensible… Lorsque Charles de Foucauld arrive à Tamanrasset en 1905, c’est un hameau de quelques dizaines d’âmes. Son ami Laperrine, responsable militaire des oasis sahariennes et fondateur des méharistes, l’y a conduit depuis Beni Abbès. Immergé en milieu étranger, parfois hostile, à 700 km du premier poste français, il ne bénéficiera d’aucune autre protection que le cœur brodé sur son vêtement. Si les soldats occupaient une partie de son ministère à Beni Abbès, à Tamanrasset il se dédie entièrement aux Touareg. Ermite, ancien officier, compagnon de cette aventure qui mêle conquête et « pacification » … Difficile mariage du spirituel qui se propose et du colon qui s’impose. Sans conteste favorable à un certain type de colonisation, persuadé que la France peut apporter une civilisation matérielle, intellectuelle et morale aux peuples de Sahara, Charles de Foucauld regrettera pourtant en 1907 : « Notre Algérie, on n’y fait pour ainsi dire rien pour les indigènes. ». Lui qui rêvait d’une chrétienté par la base, de conversions à travers l’exemple de sa vie dans l’esprit de Nazareth, aura cherché à tout concilier jusqu’au bout. En juillet 1916, quelques mois avant sa mort, il écrivait encore à son futur biographe René Bazin ce qu’il pensait d’une colonisation qui ne viendrait pas toucher les cœurs : « Si nous n’avons pas su faire des Français de ces peuples, ils nous chasseront. Le seul moyen qu’ils deviennent Français est qu’ils deviennent chrétiens. ». Un siècle plus tard, l’actualité de la bande sahélo-saharienne semble continuer de lui donner raison. Avec les dernières troupes françaises qui partent, ce sont aussi les écoles françaises qui ferment, l’anglais et l’arabe qui remplacent la langue de Sansal et de Senghor.
Ce qu’on appelle « La Frégate » est un grand cube de terre argileuse posé au milieu de la ville. C’est là que Charles de Foucauld s’établit en 1905, à l’époque à l’écart de tout. Il souhaite qu’on vienne à lui librement. Il construit une maison d’une pièce, mais la chaleur est tellement étouffante qu’il l’agrandira pour créer différentes ouvertures et permettre une circulation d’air. Là aussi, pauvreté absolue. Il dort à même le sol, célèbre la messe seul dans une chapelle qui n’est que le prolongement de sa chambre.

Le dénuement est plus grand encore qu’à Beni Abbès. Lorsqu’on lit ses lettres et carnets, il ne semble pourtant pas que les circonstances externes l’affectent. Il ne les évoque que rarement et parle surtout de sa vie intérieure, de ses combats, de ses faiblesses. Vu de loin, son style est un peu simpliste, et la matière trop pauvre ; l’ermite semble se complaire dans un langage presque enfantin. Sur place, on comprend qu’il a vécu la sécheresse du désert dans sa chair. Que sa plume reflète la rudesse de l’environnement. Dans le silence des immensités vides, les priorités changent, on n’entend plus que les battements de son cœur, et la plume prend le rythme du pouls. Tout paraît fou, surhumain : les distances, son rythme de travail, sa solitude… Impossible de sombrer dans la niaiserie, d’entonner des cantiques à l’eau de rose. L’âme se tait face au sacrifice. Le silence s’impose. C’est le vent de sable qui donne le ton. Comment un homme seul a-t-il pu tenir ? Se faire accepter ?
A l’extérieur de la palissade qui entoure l’ermitage, un homme jeune nous observe. L’État policier continue de nous suivre. Juste en face, nous sommes invités à assister à la messe de la petite communauté chrétienne. L’assemblée est composée pour moitié de subsahariens et pour le reste de visiteurs européens. Les uns ont interrompu leur transhumance vers les côtes méditerranéennes, les autres sont venus par les airs marcher sur les traces de l’ermite. La seule convergence fugitive de ces deux mondes qui s’observent sans pouvoir se comprendre laisse pantois. Sans le savoir, ils sont venus à la recherche l’un de l’autre. « Dieu, descends sur nous ton onction, je suis disposé à la recevoir », chante le chœur. Frissons garantis. « La paix commence en nous, autour de nous, avec les autres. Ensuite, elle deviendra contagieuse », rappelle le prêtre. On touche du doigt le mystère de cet apôtre de la rencontre.
Retraite en altitude
Lorsqu’on monte à l’ermitage de l’Assekrem, dans le massif du Hoggar, la beauté des lieux nous envahit. En route, les tapis blancs d’asphodèles répondent aux champs d’oseille rouge, car la saison a été pluvieuse. Sur un autre versant, le duvet argenté des feuilles indique qu’il s’agit d’armoise, l’absinthe mentionnée dans la Bible. Pour une fois, le désert est en fête ! Arrivés au col, les véhicules s’arrêtent. Ascension au sommet. L’ermitage se trouve au bord du haut plateau ouvert sur un horizon en dentelles. Le rocher et les sables pour seule compagnie, Charles de Foucauld en fera sans doute souvent le tour. « Il y a là-haut une vue merveilleuse, fantastique même, on domine sur un enchevêtrement d’aiguilles sauvages et étranges, au nord et au sud rien n’arrête la vue : c’est un beau lieu pour adorer le Créateur ». Après un moment de recueillement, nous assistons au plus célèbre coucher de soleil du pays. Le soir, dîner dans le refuge en contrebas, d’un repas préparé au coin du feu par nos chauffeurs touareg. La nuit se passe en dortoir, sur des matelas à même le sol. Certains relèveront les conditions de logement misérables… Le matin, les plus hardis montent dans l’obscurité pour assister au lever du soleil. Dans la grande intimité de ce moment privilégié, le silence s’impose à nous et la prière jaillit sans effort. « Dieu est grand », comme ils disent. Et pourtant, il s’est aussi fait si petit… Mais comment assurer un apostolat à 2780 m d’altitude ? Pas une habitation en vue, même si le regard porte jusqu’à 150 km vers le nord et le sud. Rien, ni personne. Un campement de nomade par moment ? L’ermite réalisera finalement que cet emplacement est trop reculé pour servir sa vocation de « frère universel ». Après cinq mois sur place au milieu des vents nocturnes glacés, Charles de Foucauld rentrera à Tamanrasset, et s’y fixera. Nous redescendons nous aussi par la piste cahoteuse qui ramène à la ville, à 80 km de là.
« Je ne pense plus voyager », écrit-il dans l’une de ses lettres. Charles de Foucauld aura tout tenté, mais il réalise que son œuvre n’intéresse personne, n’attire pas les Français, ne convertit pas les Touareg. Il comprend qu’il ne convaincra pas les hommes et se résigne à rester à Tamanrasset pour y faire le bien qu’il pourra encore. Soucieux de protéger la population contre le soulèvement qui a éclaté dans le Sud libyen et a atteint Djanet, plus à l’Est, il construit un véritable petit fortin, dans lequel les autochtones pourront se réfugier. Il y stocke des provisions et accepte, apparemment contre son gré, des armes qu’il ne distribuera jamais. Ce sont des fusils Gras, déjà largement dépassés, du modèle qui accompagnait Rimbaud sur une photo célèbre prise à Aden. Ici aussi, sa chambre est en enfilade de la chapelle. Lorsqu’il se lève le matin, c’est l’autel et le Christ qu’il voit. Toujours ce tête-à-tête dans la solitude.
Comme le met en évidence sa biographie par François Sureau, la vie de l’ermite des sables réunit une somme d’échecs cuisants. Parti pour évangéliser, il ne fera que deux conversions sans lendemain. Avide de vivre en frère de tous, il ne parviendra jamais à attirer durablement un seul compagnon. Voulant protéger les populations contre les razzias des tribus nomades, il mourra lui-même à l’extérieur du fort qu’il avait construit pour protéger les autres ; avec la complicité d’un jeune homme qu’il avait soigné ; et des mains d’un inconnu, « dans son affolement », comme un peu par hasard, est-il rapporté. Quelle déchéance ! Et pourtant, la grande réussite de Charles de Foucauld, c’est précisément d’avoir tout échoué : « Mon Père, je m’abandonne à toi », dit sa célèbre prière.
A l’extérieur du fort, un trou dans le mur, agrandi par les doigts des visiteurs venus toucher pour croire, témoigne de l’ultime instant.

Le 1er décembre 1916, il meurt en effet d’une balle dite perdue. On l’imagine à terre, prononcer ses derniers mots en tamashek : « Baghi n’mout » : « C’est l’heure de ma mort », « je vais mourir ». Personne pour l’assister dans cette scène de panique. Il sera découvert par des soldats français arrivés trop tard. Des années auparavant, il avait exprimé ce souhait étrange : « Je désire mourir violemment, douloureusement tué. » Moussa Ag Amastane, aménokal du Hoggar, c’est-à-dire chef traditionnel de la région où vivait Charles de Foucauld, écrivit dans une lettre à sa petite sœur Marie de Blic : « Charles le marabout n’est pas mort que pour vous autres seuls, il est mort aussi pour nous tous ». Ami de Charles de Foucauld, ce guerrier avait prêté allégeance à la France… Laperrine et Charles de Foucauld seront provisoirement ensevelis côte à côte.
Un serviteur inutile

Comme un artiste en avance sur son temps, Charles de Foucauld n’assistera pas à sa reconnaissance posthume. Ignoré de son vivant, il n’a cessé depuis un siècle d’alimenter les plumes et de nourrir les vocations. A ce jour, pas moins de 10 communautés se réclament de lui, et les visiteurs affluent autour des témoignages de son passage. Le séjour de l’ermite en milieu musulman en fait d’ailleurs un précurseur et un prophète. En attendant, l’Etat algérien n’invite pas vraiment à la mission, puisque l’entrée des églises est interdite aux mineurs algériens et que les visites sont strictement séparées des offices. Au nom d’Allah ou de la laïcité ? Ni l’un ni l’autre, et c’est toute la complexité d’un pays tiraillé. D’ailleurs, parmi les écrivains franco-algériens, Kamel Daoud est interdit de vente et Boualem Sansal en prison depuis le 16 novembre, car l’un et l’autre ont eu le malheur de remuer le passé et de questionner le présent. Crime de lèse-majesté ? Visiter l’Algérie rappelle la Syrie d’Assad : des forces de l’ordre omniprésentes, un contrôle permanent de l’information et des individus, comme une angoisse de laisser vivre les hommes. Comment réconcilier avec lui-même ce pays qui vit de ses blessures ?
La présence de communautés chrétiennes au sein de la société algérienne mérite toute notre admiration et notre soutien. L’esprit de Charles de Foucauld n’est pas mort avec lui, il brille à travers les figures admirables qui perpétuent son souvenir. Il ne demande qu’un peu de liberté pour éclore, comme dans le désert les fleurs après la pluie. A la mélancolie ou la révolte des écrivains qui ont marqué l’histoire du pays, Charles de Foucauld oppose l’acceptation. « Fais de moi ce qu’il te plaira », dit sa prière d’abandon. Il ne demande que cette fameuse dernière place, celle que personne ne souhaite, histoire d’imiter le Christ, mais aussi d’établir la paix autour de lui. Il rêvait d’un destin collectif, il est mort seul et misérable. Mais seule comptait pour lui la finalité invisible et, quelques heures avant sa mort, il écrivait encore à sa cousine Marie : « Comme c’est vrai, on n’aimera jamais assez ; mais le bon Dieu, qui sait de quelle boue Il nous a pétris et qui nous aime bien plus qu’une mère peut aimer son enfant nous a dit, Lui qui ne meurt pas, qu’Il ne repousserait pas celui qui vient à lui… ».
Le moment est venu de regagner le vieux continent. De survoler encore une fois ce désert fécond, d’entrevoir par le hublot les flots qui ont englouti l’avion de Saint-Exupéry. Grand bond trop rapide par-dessus ces deux univers mystérieux qui ont tant inspiré les hommes. Atterrissage prévu à Paris en milieu de journée. Aéroport, RER, centre-ville. Comment le vicomte de Foucauld, converti à l’Eglise Saint-Augustin, rebaptisé Charles de Jésus, peut-il parler à nos contemporains errants, assoiffés de spiritualité ? Peut-il toucher nos sociétés partagées entre la fièvre de consommation et celle de la violence ? Les Algériens aiment aujourd’hui à souligner que le premier éveil spirituel de Charles de Foucauld a eu lieu au contact de la piété des musulmans, lors de sa fameuse « Reconnaissance du Maroc ». Cette vérité, comme son rapport mystérieux à l’islam, n’ont pas fini d’alimenter nos méditations sur le sujet. On a essayé de dénaturer son ministère en affirmant qu’à la fin de sa vie il avait même abandonné sa croix. Ce choix peut effectivement choquer. Mais qui n’a pas vécu l’immersion totale en milieu musulman ne peut juger ce qui lui permettait d’approcher et de toucher au mieux la population « indigène », comme il aimait à dire avec tendresse. Quand il se voue « aux plus pauvres », il pense bien à ceux qui ne connaissent pas le Sacré Cœur. En 1902, il lui a consacré toute la mission du Sahara.
Missionnaire d’une chrétienté en reflux, Charles de Foucauld a adapté la voile au vent qui tournait. Il a revisité pour notre époque l’idéal des Pères du désert. Personnalité rugueuse par son austérité, il reste universellement incontestable grâce à sa charité vécue. Il incarne par excellence la figure capable de réunir ces civilisations qui se choquent à présent sur nos territoires, car, dans sa radicalité, il a tout embrassé. Il a aimé sa famille et ses amis en les nourrissant de lettres régulières ; il a accompagné ses compatriotes en armes avec les sacrements ; il a chéri cette terre d’Algérie en y apprenant la langue, les codes, les gestes ; il a servi les indigènes en les accueillant, en les soignant et en offrant le témoignage de sa vie ; il a finalement aimé Jésus et Marie en cherchant à s’identifier à eux en tout. Une phrase le résume bien : « Je voudrais être assez bon pour qu’on dise : Si tel est le serviteur, comment doit être le maître ? ». Le Christ en croix qui orne le mur de son ermitage de Beni Abbès dit tout de son auteur : il regarde au loin et embrasse l’humanité de ses bras déployés.
Saint-Exupéry avait-il lu Charles de Foucauld ? Comme lui, il mourra dans l’action, prince des nuées happé par une mer en furie avec laquelle il avait tant joué. Lui aussi aimait le désert, l’aventure, la découverte, le risque, les autres… Sa fraternité s’appelait camaraderie et son amour du ciel prenait des airs d’étreinte physique, jusqu’à la chute finale en forme d’épectase. Quand l’un rédigeait des règles de vie pour des communautés imaginaires, l’autre rêvait à une terre où les hommes seraient transcendés par une ascension commune. Les deux aimaient autant le silence de la solitude que la présence de leurs frères humains. Travailleurs infatigables, ils ont pareillement ciselé leur âme à force de contraindre leurs corps. Témoins de l’au-delà, ils sont repartis comme ils souhaitaient quitter le monde : violemment, dans l’exercice de leur passion ; le premier en bataillant avec le vent et les vagues, le second à genoux, puis couché, répandant son sang sur cette terre qu’il avait tant aimée. Tous deux étaient à leur façon des chevaliers du ciel.
Pour aller plus loin: