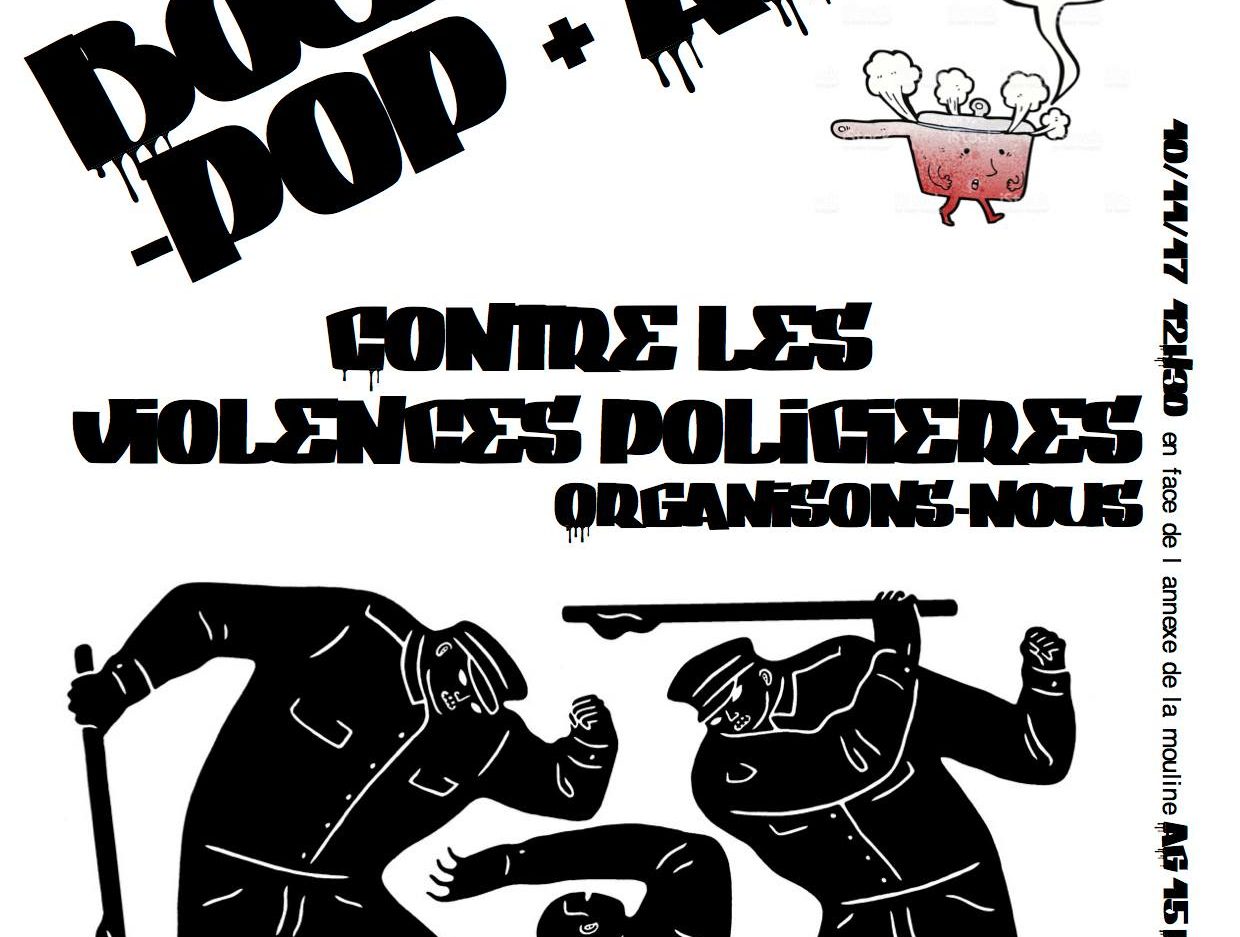« Le progressisme radical est un système de croyances fabriqué par et pour les élites »
Il faut d’abord se représenter ce repas de famille qui menace à tout moment de mal tourner. En réalité, tous les éléments seraient réunis pour que la soirée soit belle, mais vous subissez depuis deux heures un ayatollah du progressisme qui, sans jamais esquisser le moindre sourire, vous assène un tableau impitoyable de notre société. Raciste, sexiste, arriérée... selon lui, la société occidentale cumule tous les défauts et vous-mêmes, cela va sans dire, en êtes un représentant fort coupable en votre qualité d’hétérobeauf cisgenre.Que faire ? Endurer ça jusqu’au bout ou mettre les pieds dans le plat avec flamboyance ? Si vous…