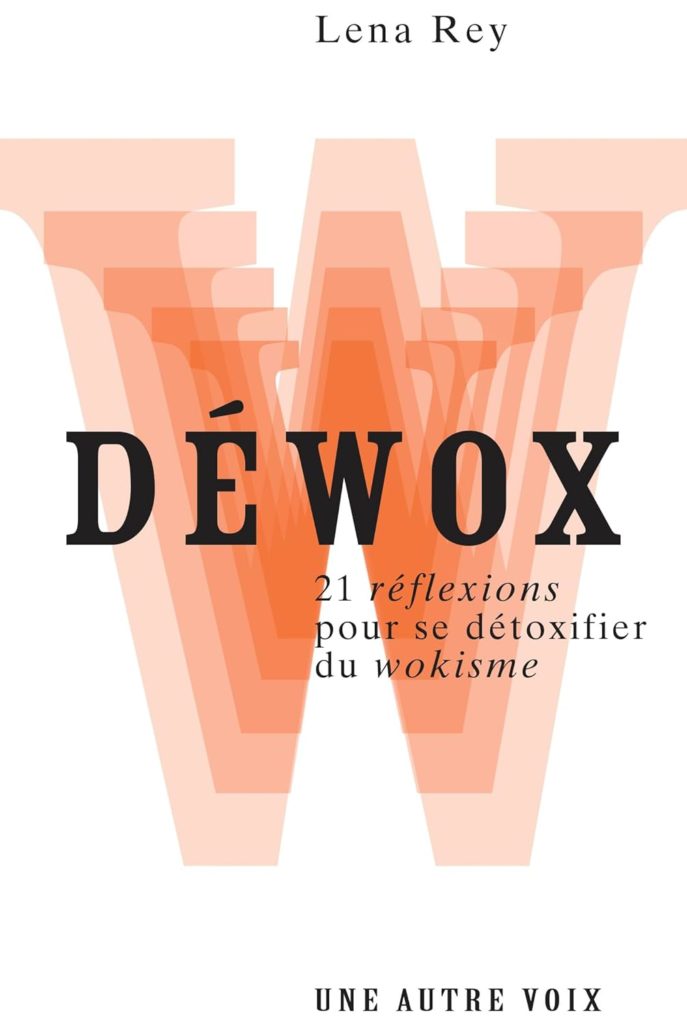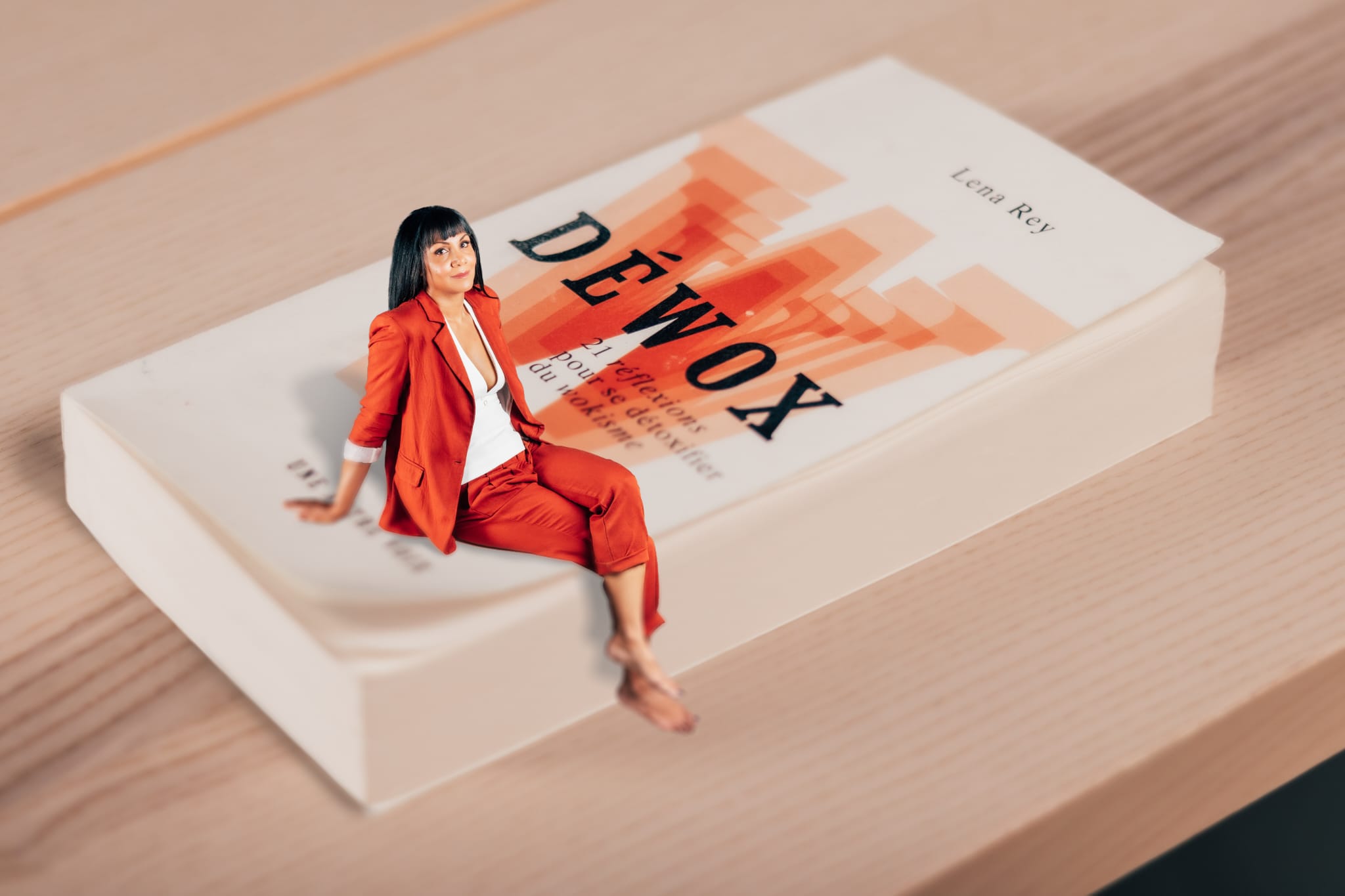Journaliste, spécialiste des questions de sécurité et, désormais, essayiste : avec Déwox – 21 réflexions pour se détoxifier du wokisme, la Genevoise Lena Rey signe un essai à mi-chemin entre le pamphlet et le manuel de développement personnel pour échapper au progressisme moderne.
Si sa plume est souvent légère, drôle, voire tendre envers ses adversaires, la volonté de se bagarrer avec les concepts n’en est pas moins farouche. Mais pourquoi retourner au combat contre une idéologie dont plus personne ne se revendique ?
Lena Rey, ce qui frappe d’abord dans votre essai, c’est la manière dont vous transformez un combat idéologique en méthode de développement personnel, avec des « cures » à suivre. Pourquoi avoir choisi ce format presque thérapeutique pour aborder une question politique ?
Parce que nous vivons dans une société qui saigne. J’entends par là « la société du spectacle » dans laquelle on nous donne « du pain et des jeux ». On attend de voir le gladiateur en sang, le taureau mis à mort. C’est une corrida contre nos esprits et on ne s’en rend même plus compte. Pourtant, dans les médias, ce phénomène s’observe bien. Nous avons tellement peu d’espace d’esprit disponible, croulants sous un excès de communication et d’information, qu’il faut absolument capter le trésor de notre attention. Alors pour un média généraliste, comment se démarquer ? En suscitant les émotions les plus puissantes : la peur et la colère. Nous en avons besoin pour nous indigner et enclencher le moteur de l’action. Sauf qu’à force, même ça ne provoque plus rien, nous réagissons comme des opossums sidérés, comme si faire le mort était la seule réponse dont nous sommes capables avec des cerveaux presque en encéphalogramme plat.
Ce n’est pas ce que je cherche avec mon livre, je l’ai pensé pour qu’il soigne. On a besoin de se faire du bien, de laisser la place aux émotions positives : le rire, l’amour. On parle plus volontiers des cures détox pour le corps, j’ai voulu me soumettre à l’exercice d’en imaginer une pour l’esprit.
Message important !
Cet entretien vous est offert pour que vous puissiez découvrir une pensée originale.
Mais pour continuer, nous avons besoin de vous !
Abonnements : https://lepeuple.ch/sabonner/
Dons : https://lepeuple.ch/nous-soutenir/
En pages 58-59, vous avancez une intuition originale : ce que la droite appelle « wokisme » serait, selon vous, une tentative un peu désordonnée de réparer un manque d’amour par un surcroît de justice. Peut-on vraiment combattre un mouvement idéologique de fond avec des câlins et des sourires ?
Si on vivait au pays des Bisounours, je répondrais que oui : on aurait tous droit à notre câlin réparateur. Mais après tout, ont-ils totalement tort ? Ou est-ce qu’on pourrait faire l’effort un instant – juste pour l’exercice mental – de se mettre dans la peau d’un Bisounours. On verrait que le monde est complexe mais qu’avec une bonne dose d’amour, tout devient plus clair. Ils diraient « on peut s’aimer même si on n’est pas d’accord ». Hélas, nous vivons dans un monde bien trop polarisé pour que ça fonctionne aussi facilement. Aujourd’hui, si tu es un ours blanc, même avec un immense cœur en couleur, on va t’accuser de tous les maux. Comment répondre à ça ? En donnant naissance à des prophéties autoréalisatrices et en leur donnant à voir exactement ce dont ils nous accusent ? Surtout pas ! Qu’est-ce qu’on a à gagner par la violence ?
Les pages que vous mentionnez s’inscrivent dans un chapitre qui s’intitule tout simplement « Amour » et qui invitent à se souvenir de son sens. J’affirme que nous avons besoin d’entendre répéter des banalités puisqu’elles ont cédé la place aux discours les plus farfelus. Prononcer des évidences semble être devenu subversif, courageux, salvateur. Alors je le dis simplement, on ne combat pas cette idéologie tautologique par la violence, on la bat sur le terrain des idées et avec bienveillance, car les guerriers de la justice sociale sont manipulés. Ils se trompent de cible et de cause. On leur promet des solutions qui n’en sont pas. En cela ils sont victimes, mais pour le comprendre, il faut faire preuve d’empathie et parler. Et on le sait – c’est une règle élémentaire de communication – avec le sourire ça passe toujours mieux. On a déjà essayé de se faire la guerre, et si on tentait autre chose ?
Y a-t-il encore, du reste, un courant homogène qu’on pourrait appeler le wokisme, selon vous ? Vous parlez vous-même d’un « gloubi-boulga » de causes, dans votre livre.
Le wokisme n’est pas un courant homogène, c’est justement ça, le piège. Il avance masqué, sous des causes qui semblent légitimes : lutte contre le racisme, contre le sexisme, contre l’homophobie… Mais il finit par tout mélanger, tout confondre, et mettre le feu à tout ce qu’il touche. Il n’y a qu’à voir les tensions internes : regardez comment sont traitées les féministes qui osent encore dire qu’une femme ne peut pas avoir de pénis.
Oui, j’emploie le mot gloubi-boulga dans mon livre, parce qu’on est face à une espèce de marmite idéologique dans laquelle on a jeté du militantisme émotionnel, des morceaux de pseudo-sciences sociales, un paquet de ressentiment, et beaucoup de moraline.
Et comme dans tout bon rituel sacrificiel, il faut bien un coupable à faire bouillir : alors on y plonge l’homme blanc hétérosexuel, Donald Trump, et tout ce qui symbolise le mal absolu dans cette vision du monde.
Le wokisme devient cannibale et finit par dévorer ses propres enfants. Amusant, pour un mouvement bourré de végans.
La cause initiale était juste : lutter contre les injustices raciales aux États-Unis, dans un contexte qui n’est pas le nôtre. C’est un problème qu’on n’aurait jamais dû importer tel quel.
Il y a là-dedans un mécanisme de contamination : il prend le contrôle du langage, des émotions, des normes – pour devenir la norme. Il transforme tout en champ de bataille identitaire. Et il nous a transformés, nous, en bons toutous dociles, conditionnés au réflexe pavlovien : tu dis un mot de travers, tu es out.
Si bien qu’aujourd’hui, les jeunes non-wokes ont parfois l’impression d’être minoritaires… alors qu’ils ne le sont pas.
Ils sont juste silencieux. Pour l’instant.

Votre troisième « cure » s’attaque à ce que vous appelez l’« apocalypse cognitive » : la surconsommation d’écrans rendrait les gens plus influençables, donc plus vulnérables au wokisme. Pourtant, cette idéologie s’est d’abord développée dans les milieux universitaires, où on lit encore beaucoup… N’y a-t-il pas là une contradiction ?
Déjà, être universitaire ce n’est pas vivre sans portable, donc l’influence des réseaux sociaux se retrouve tout autant chez un étudiant en lettres que chez n’importe quel jeune. Ensuite, il faut reconnaitre qu’on y lisait beaucoup, j’insiste sur l’imparfait. C’est toujours le cas pour certains, mais d’autres y vont plutôt à coups de résumés en ligne et intelligence artificielle, sans se soucier vraiment de développer leur esprit critique. Néanmoins si on schématise, l’université est un espace où on a le temps de se poser beaucoup de questions. Trop peut-être. Quand une personne sait qu’elle va devoir marcher 40 kilomètres pour ramener de l’eau dans son village, devoir se taper 17 clients qui puent si elle ne veut pas se faire frapper et affamer par son mac, ou qu’elle entend les bombes siffler au-dessus de sa tête, étonnement elle n’est pas woke. Donc il y a clairement une corrélation entre les sphères « privilégiées » et la germination du wokisme. Sur un terrain connecté à la réalité crue et où le confort est un luxe, ça ne prend pas. C’est aussi certainement parce que l’université a été polluée par Foucault et sa clique, qui semaient à tout va, plus vite qu’un pissenlit au vent. Un virus intellectuel dont on a de la peine à se débarrasser. Ramenons le débat aux vrais problèmes et demandons à un enfant qui gratte du cobalt dans une mine du Congo, pour qu’on puisse poster nos indignations sur Instagram, s’il ressent le poids du patriarcat.
En page 113, vous opposez le bon sens des filières manuelles à l’absurdité de certaines recherches en études décoloniales. Ne flirtez-vous pas ici avec une forme d’anti-intellectualisme, alors que votre essai relève lui-même des sciences humaines ?
J’ai un attachement particulier pour le chiffre 113, c’était mon matricule dans la police. Mais anecdote à part, ce que je critique, ce n’est pas l’intellect, mais l’intellectualisme vide. Michel Foucault disait lui-même en substance que si ses écrits n’étaient pas un peu abscons, personne ne croirait qu’ils sont profonds. Je n’oppose pas les filières manuelles aux sciences humaines – je voudrais les réconcilier autour du bon sens. Il y a dans les métiers manuels une forme d’intelligence du concret qui manque cruellement à certaines théories désincarnées.
Mon livre ne rejette pas la réflexion critique, je crois pouvoir dire qu’il en est l’exercice. Mais un bon chercheur, comme un bon menuisier, doit se demander si ce qu’il produit tient debout.
À la page 127, vous affirmez qu’il faut répondre au wokisme par une information rigoureuse et « pédagogique ». Mais vos adversaires ne sont pas des enfants. Ce ton bienveillant, presque maternel, n’est-il pas en décalage avec la virulence de vos critiques ?
Je préfère parler de contradicteurs plutôt que d’adversaires. Le mot est plus juste, car je ne cherche pas le conflit, mais la clarté.
Justement, certains de mes contradicteurs tiennent le raisonnement binaire d’un enfant de cinq ans : il y aurait les gentils inclusifs d’un côté, et les méchants réactionnaires de l’autre. Une vision étonnamment manichéenne du monde, venant de la part de ceux qui passent leur temps à déconstruire la binarité ! On en viendrait presque à leur rappeler que le réel, comme l’arc-en-ciel qu’ils affectionnent tant, est fait de dégradés, de nuances, et pas d’oppositions simplistes.
Donc oui, parfois, un ton pédagogique et bienveillant est exactement ce qu’il faut, pas pour infantiliser, mais pour ramener un peu de raison là où règne l’émotion, pour ramener sur un terrain où on peut discuter. Pour cela, j’aime faire référence à des contes, des fables, utiliser des allégories comme l’humanité l’a toujours fait autour de ses mythes rassembleurs.
Dans une note en page 182, vous semblez assimiler toute remise en cause de l’universalisme des Lumières à une position « woke ». N’est-ce pas un peu rapide ? Ce type de critique peut aussi venir d’un conservateur soucieux du réel, non ?
Bien vu, oui dans une note de bas de page j’écris ceci : « les wokes voient dans cet universalisme, une forme de réductionnisme qui ignore les différences culturelles, historiques et sociales, imposant des valeurs « occidentales » comme normes universelles. Les perspectives wokes considèrent que l’idée de rationalité pure peut renforcer des structures de domination, car ce qui est « rationnel » ou « objectif » est souvent défini par ceux qui détiennent le pouvoir, au détriment des expériences et savoirs des minorités. »
Je ne veux pas réduire toute remise en question de l’universalisme à une position woke, mais je m’étonne que ceux qui en appellent aux droits de l’homme puissent à ce point rejeter l’idée même qu’il puisse exister des principes communs. Vous avez raison de rappeler que la critique de l’universalisme ne vient pas toujours de l’aile progressiste. Il existe en effet des penseurs conservateurs qui questionnent certains excès de l’universalisme abstrait. Mais ces critiques-là ne cherchent pas à dissoudre l’idée d’un commun, ni à atomiser la société en une infinité de subjectivités victimaires. Ce que je vise dans ce passage, c’est la dérive relativiste – je dirais même nihiliste – portée par certaines approches dites « décoloniales », qui finissent par nier l’idée même de vérité ou de raison partagée, sous prétexte qu’elles seraient culturellement situées. Ne pouvons-nous pas nous mettre d’accord sur le fait qu’il existe un socle de principes universels à défendre, et nous demander ce que nous pouvons garder, (ou même réinventer soyons fous) de cet universalisme ? Parce que si tout est une construction sociale, alors l’idée même de construction est une illusion… et on finit par déconstruire jusqu’à sa propre chaise. À ce stade, autant militer allongé. Il ne me reste plus qu’à aller me coucher. …ah non, mince, l’interview n’est pas terminée [rire].
Enfin, dans votre « cure » numéro 18, vous livrez une critique très dure de la publicité et du capitalisme. Une question s’impose : et si, au fond, vous étiez de gauche ?
J’avoue, j’y suis allée un peu fort. Nous sommes tellement imprégnés de ce capitalisme qu’il devient difficile de le critiquer dans son ensemble. Il est essentiel de prendre assez de recul avec notre symbiote capitaliste pour en observer la version néolibérale, totalement folle, dérégulée, intrusive et prédatrice, qui colonise jusqu’à nos émotions et nos désirs. Je suis attachée à la liberté, mais je refuse l’extension des logiques de marché à tous les domaines de la vie, que tout devienne un produit et qu’il soit nécessaire de consommer pour afficher sa vertu.
Ce que nous avons à y perdre ? Notre humanité.
Car l’humain ne se résume ni à ses apparences, ni à ses performances, ni à ses identités de surface. Ce qui nous rend profondément humains échappe aux slogans. C’est justement ce qui ne se vend pas, ce qui ne se voit pas, ce qui ne rapporte rien -sinon du sens.
Il y a, à gauche comme à droite, des personnes sincèrement préoccupées par les vraies inégalités : l’accès à la santé, à un travail digne qui permette de payer ses factures, le soutien à la maternité à une époque où être maman, c’est devenir une gueuse aux yeux de la société, ou encore les droits des pères qu’on voudrait effacer. J’ai beaucoup de respect pour la vraie gauche sociale, celle des actes. Mais j’ai plus de mal avec la gauche des postures, celle qui brille dans les grandes idées sociétales pendant que la famille s’effondre – et tout notre socle de valeurs avec elle. Cette gauche caviar-là ne cherche qu’à masquer sa malhonnêteté crasse et le vide abyssal de son cœur.
Alors si critiquer le capitalisme débridé me range à gauche, très bien. J’adorerais avoir le luxe d’être de gauche, mais on n’en est plus là. Ramenons le débat au conservatisme, qui permet de mieux comprendre ce qui se joue. Utilisons-le comme contrepoids au progressisme qui fonce tête baissée sur un lac gelé, vers une destination que je n’ai pas envie de connaître.
Après tout, il n’y a pas que les saumons qui nagent à contre-courant. Parfois, c’est une question de survie et, ce système basé sur la dichotomie surannée de gauche – droite ne veut plus rien dire lorsque la survie de notre rapport au réel et aux fondements de nos sociétés est en jeu.