Ce n’est pas un sujet que l’on aborde depuis un point neutre, surtout lorsque l’on s’inscrit, même à distance critique, dans une tradition intellectuelle marquée par Maurras, par son exigence du réel, son refus des abstractions morales, mais aussi par des aveuglements dont l’antisémitisme doctrinal fut l’un des plus lourds. C’est précisément cette tension héritée qui rend ce livre nécessaire. Ni plaidoyer ni repentance rituelle, il propose une discipline de l’intelligence : distinguer sans absoudre, comprendre sans dissoudre, et accepter les tensions que ni la politique ni la morale immédiate ne peuvent clore sans violence. Il ne cherche pas à pacifier artificiellement un conflit ancien ; il en prend la mesure, au risque d’en reconnaître l’irréductibilité.
Il suffit d’ouvrir un journal, aujourd’hui, pour constater que certains mots ne servent plus à penser mais à disqualifier. « Antisémitisme », « Israël », « sionisme », « Occident chrétien » : ils circulent dans l’espace public comme des pièces brûlantes que chacun se passe à la hâte, de peur d’être celui qui les garde trop longtemps. Ils n’ouvrent plus un espace de compréhension ; ils assignent, soupçonnent, ferment.
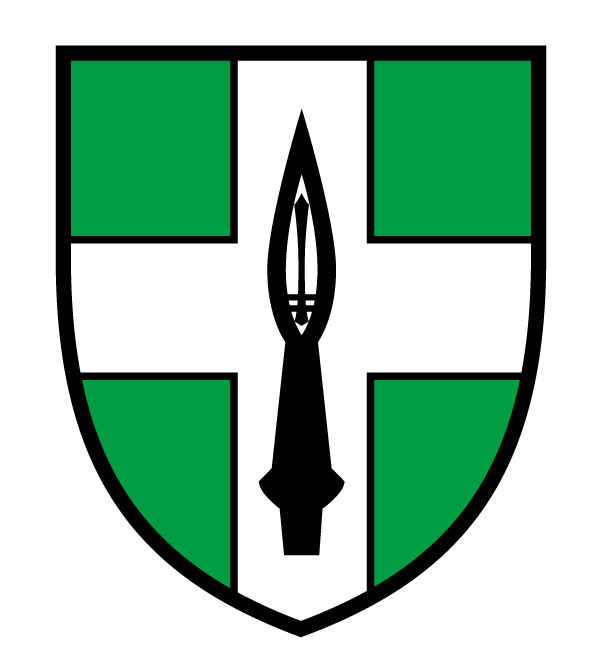
J’ai lu ces pages un soir de semaine, tard, alors que les journaux empilaient à nouveau les mêmes mots, les mêmes accusations, les mêmes indignations automatiques. Dans ce climat de fébrilité morale, Frères ennemis apparaît comme un objet presque déplacé. Trop lent. Trop précis. Trop peu maniable dans l’économie de l’indignation. Et c’est précisément ce décalage qui fait sa force.
Deux lectures concurrentes d’un même héritage
Le livre ne part pas de l’actualité immédiate. Il part d’un fait plus ancien, plus résistant, que l’actualité ne fait que réactiver : le judaïsme et le christianisme ne sont pas deux traditions étrangères l’une à l’autre, mais deux lectures concurrentes d’un même héritage. « Ceux dont nous allons parler sont des frères » (p. 7). La phrase est dépouillée, presque sèche. Elle n’appelle ni réconciliation de façade ni concorde fabriquée. Elle désigne une structure. Les conflits durables naissent moins de l’altérité que de la proximité irréductible. La Bible elle-même n’a jamais idéalisé la fraternité ; elle sait que le lien le plus proche est aussi le plus exposé à la violence.
Les conflits durables naissent moins de l’altérité que de la proximité irréductible.
Ce rappel est décisif à l’heure où l’on voudrait soit réduire l’antisémitisme à une pathologie marginale, résiduelle, étrangère à notre modernité éclairée, soit l’étendre indistinctement à toute critique politique contemporaine, au risque d’en faire une arme de disqualification. Delacrétaz refuse ces deux facilités. Il commence par désagréger le concept lui-même : « Il n’y a guère, dans la langue française, de terme plus fondamentalement connoté que celui d’antisémitisme » (p. 10). Cette charge tient au fait que le mot recouvre des réalités empilées au fil des siècles : antijudaïsme antique, antijudaïsme chrétien, antisémitisme racial, pseudo-scientifique, idéologique, complotiste. Les confondre revient à dissoudre les responsabilités historiques et à rendre l’histoire muette.
Message important !
Cette chronique vous est offerte pour promouvoir un débat plus serein. Mais nous avons besoin de vous:
Abonnements : https://lepeuple.ch/sabonner/
Dons : https://lepeuple.ch/nous-soutenir/
! Nouveau ! Notre manuel de survie médiatique (9.90 CHF) : https://lepeuple.ch/librairie-du-peuple/
Le cœur de l’ouvrage se situe là où nombre de discours contemporains se dérobent : dans la théologie. Non par goût du dogme, mais parce que le conflit ne se comprend pas sans elle. L’élection d’Israël n’y est jamais présentée comme un privilège mesurable ou négociable, mais comme une initiative divine irréductible aux catégories humaines de l’équilibre et de la réciprocité. Delacrétaz souligne le caractère profondément dissymétrique de cette élection, souvent perçue comme vexatoire, voire insupportable pour ceux qui la considèrent de l’extérieur (p. 10). Cette dissymétrie heurte la raison politique, toujours tentée par l’égalisation abstraite.
La question de la substitution
C’est dans ce cadre qu’apparaît la question décisive de la substitution. Du point de vue chrétien, l’Église se comprend comme l’accomplissement des promesses faites à Israël, lecture cohérente dans son propre système théologique. Mais Delacrétaz en expose sans détour la contrepartie : du point de vue du peuple juif, cette affirmation est vécue comme une spoliation de ses Écritures, de son histoire et de son rôle face à Dieu (p. 17). Il n’y a pas ici de synthèse possible sans trahison. Toute tentative de conciliation conceptuelle produit une violence symbolique. La tension n’est pas un accident ; elle est constitutive. En refermant ce chapitre, on n’est pas apaisé. Et ce serait plutôt mauvais signe si on l’était.
Le tournant historique survient lorsque le christianisme devient religion d’Empire. Les catégories théologiques cessent alors d’être des instruments de lecture du mystère pour devenir des instruments d’organisation du monde. « Le Juif cesse d’être un mystère pour devenir un problème » (p. 19). La violence ne procède pas d’abord de la haine déclarée, mais de la normalisation : quand une idée devient règle, puis statut, puis administration.
L’analyse se prolonge dans la modernité. L’émancipation, l’assimilation, la citoyenneté conditionnelle apparaissent comme des réponses rationnelles à une question mal posée. « Assimiler, c’est parfois contraindre l’autre à devenir étranger à lui-même » (p. 35). L’assimilation ne supprime pas la différence ; elle la rend illégitime. Elle tolère l’individu à condition que l’enracinement se fasse discret, puis muet.
Les chapitres consacrés à l’antisémitisme moderne refusent toute causalité unique. Antisémitisme d’État, racial, pseudo-scientifique, idéologique : ces formes se superposent plus qu’elles ne se succèdent. Leur point commun n’est pas une doctrine précise, mais une fonction symbolique. Le Juif devient une cause universelle, une explication totale du mal (p. 41). Le complotisme apparaît alors comme une explication globale qui dispense de toute responsabilité : une métaphysique de substitution qui rassure en fermant le réel.

Une exigence: comprendre
La Shoah introduit une rupture irréversible. Delacrétaz n’en fait ni un absolu rhétorique ni un argument terminal, mais un seuil. Auschwitz impose que tout discours chrétien sur le judaïsme soit désormais éprouvé, corrigé, reconfiguré (p. 47). Les textes de Vatican II constituent une étape nécessaire, mais insuffisante si l’on se contente de condamner sans renoncer aux catégories intellectuelles qui ont rendu la violence pensable et durable (p. 52). Je ne suis pas certain que nous sachions encore lire ces textes sans y projeter nos peurs contemporaines — et je ne m’en exclus pas.
Le livre surprend enfin par sa lucidité locale. Les pages consacrées à la Ligue vaudoise, à La Nation et à Maître Regamey refusent à la fois l’anachronisme moral et l’excuse patrimoniale. « Contextualiser n’est pas absoudre » (p. 66). Comprendre un milieu, une époque, un pays, n’efface pas la responsabilité intellectuelle de ceux qui ont forgé des idées appelées à produire des effets durables.
La conclusion revient à saint Paul, notamment dans l’Épître aux Romains (versets 9–11). Le temps long d’Israël n’est pas une anomalie à résoudre, mais une donnée à porter. Delacrétaz montre que ce temps long constitue une épreuve pour le christianisme lui-même : épreuve de retenue, de non-clôture, de patience (p. 60). L’Église n’est pas appelée à résoudre cette tension, mais à vivre sans la nier.
Frères ennemis n’est ni un livre de circonstance ni un texte militant. C’est un travail de tenue intellectuelle. Delacrétaz y montre comment des idées cohérentes, lorsqu’elles cessent d’être interrogées par le réel et par l’histoire, finissent par engendrer des effets qu’elles ne reconnaissent plus comme les leurs.
À l’heure où l’actualité exige des alignements rapides et des fidélités immédiates, cet essai rappelle une exigence plus rude : penser lentement, distinguer patiemment, accepter de ne pas conclure trop vite. Non pour se donner raison, mais pour accepter d’en répondre. Car la fraternité, lorsqu’elle est réelle, ne rassure pas : elle oblige.
Olivier Delacrétaz, Frères ennemis – Point de vue d’un chrétien sur l’antisémitisme, Cahier de la Renaissance vaudoise 162, Lausanne 2025.
Pour le commander: cliquer ici




