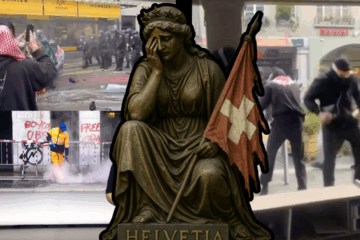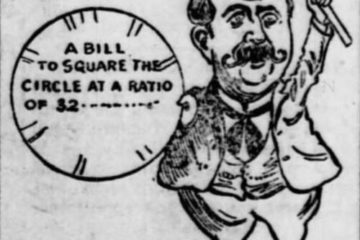En 2024, la célébration des 150 ans de la naissance du général Henri Guisan (1874-1960), qui commanda l’armée suisse pendant la deuxième Guerre mondiale, est passée inaperçue. Elle a au moins donné lieu à la réédition d’un livre de Jean-Jacques Langendorf, rédigé à l’origine en 2003, et consacré aux rapports entre Guisan et le peuple suisse. Que le 80e anniversaire de la fin du service actif (20 août 1945) soit l’occasion de rendre un modeste hommage à cette grande figure de la Suisse d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Une chose m’a toujours frappé. Dans un pays aussi peu tourné vers la chose militaire que la Suisse, les deux héros nationaux sont précisément des militaires de carrière. Il y a peu de villes suisses qui n’aient une rue, une place ou un quai qui porte le nom du général Dufour ou du général Guisan. Cela suffit à rappeler que l’on a bien eu conscience, à une époque, de ce que ces deux hommes avaient représenté et des souffrances qu’ils avaient contribué à éloigner.
Le livre de Langendorf est rempli d’une amertume que l’on ne peut malheureusement que partager. Je me souviens très précisément que c’est à partir de l’échec de la commémoration des 50 ans de la Mob en 1989 que la Suisse – et encore plus sa partie francophone – est entrée dans une spirale d’autodénigrement suicidaire et de dénationalisation. Ajoutons à cela la volonté générale des Européens de sortir de l’histoire et d’oublier que, comme l’a écrit un autre général (Charles de Gaulle), « l’épée est l’axe du monde ». Tous les pays qui se seront rêvés en royaume des Bisounours seront condamnés, pour avoir détruit leur propre armée, à connaître l’armée des autres.
La vérité doit être rétablie
En tout cas, dans le cas de la Suisse, toute l’entreprise de démolition du pays a été accompagnée par la volonté de dénigrer, de nier ou de relativiser tout ce qu’a fait le général Guisan, ne serait-ce que parce que son action résumait et justifiait tous les sacrifices consentis pour la défense nationale. La justice, mais aussi la simple volonté de survie, exige que la vérité soit rétablie.
Né à Mézières dans le canton de Vaud le 21 octobre 1874, fils de médecin, Guisan hésite longtemps à embrasser la carrière des armes – hésitation que permet le système suisse d’armée de milice – et ce d’autant plus que son mariage avec Mary Doelker, fille d’un ancien boulanger enrichi dans le commerce des grains et l’immobilier, l’a libéré des soucis matériels. École de recrues en 1894, lieutenant la même année, premier lieutenant en 1898, capitaine en 1904, major en 1908, lieutenant-colonel en 1916, colonel en 1921, il ne devient militaire professionnel qu’avec son accession au grade de divisionnaire en 1926 après 3’560 jours de service (page 17). (Je n’ai pas trouvé dans son livret de service, reproduit page 34 du livre de Langendorf, un passage par le grade de brigadier.) Il sera commandant de corps en 1931, et élu général (grade qui n’existe en Suisse qu’en tant de guerre et qui correspond en fait à une fonction de généralissime dans les autres armées) par l’Assemblée fédérale le 30 août 1939 par 204 voix sur 229 membres présents.
C’est ici le lieu de rendre hommage à Rudolf Minger (1881-1955), paysan bernois qui fut le premier conseiller fédéral UDC, en charge du Département militaire de 1929 à 1940. D’abord parce que Minger réussit à imposer à la Suisse, dans les années 1930, un effort militaire sans commune mesure avec celui d’autres pays neutres, dont le manque de préparation allait faire des proies faciles de l’Allemagne nazie en 1940. Au moment où la seconde Guerre mondiale commence le 1er septembre 1939, la Suisse de 4 millions d’habitants est en mesure d’aligner 400’000 soldats, contre 90’000 pour la Norvège ou 15’000 pour le Danemark (page 25). Ensuite parce que Minger a pesé de tout son poids en faveur de l’élection de Guisan, qui se révélera avoir été l’homme de la situation et le meilleur choix possible.

En septembre 1914, alors que sa situation paraissait plus que compromise, la France est parvenue à renverser le sort des armes parce qu’elle avait un vrai chef à la tête de ses armées : Joseph Joffre. En 1940, l’armée française, réputée jusqu’alors la meilleure du monde, sera écrasée en cinq semaines parce qu’elle avait à sa tête un officier qui plaisait à la gauche pacifiste, mais qui eut un art consommé pour faire porter le chapeau à ses malheureux subordonnés du type Corap ou Georges : Maurice Gamelin. Pour la Suisse de 1939 à 1945, Henri Guisan aura été un vrai chef. Comme Joffre. Celui qui assume la responsabilité des décisions qu’il a prises.
Bien entendu, en Europe, l’armée est subordonnée au pouvoir politique, et cela vaut pour les démocraties comme pour presque toutes les dictatures. Les rapports de Guisan avec le chef du département militaire, qui étaient excellents avec l’UDC bernois Minger, seront tumultueux avec le radical saint-gallois Karl Kobelt. De même que Guisan n’éprouvera qu’aversion pour le radical vaudois Marcel Pillet-Golaz, en charge des Affaires étrangères de 1940 à 1944. Cela étant, pour le plus grand bien du peuple suisse, Guisan parviendra à faire prévaloir ses vues dans son domaine de compétence.
Quand la Suisse était encore énergique
La suite de cet article est visible de nos seuls abonnés (veuillez vous connecter).
Merci de votre soutien et de vos abonnements indispensables pour que nous puissions poursuivre notre chemin.