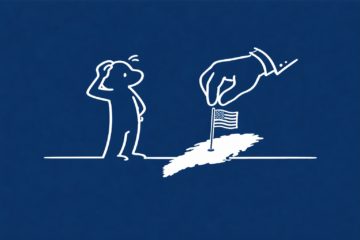Qui aurait songé à un jour voir le canton de Vaud, jadis chantre de la prospérité mesurée, vaciller dans l’incertitude budgétaire ? Et pourtant, les derniers comptes cantonaux le confirment : la situation se teinte d’un carmin inquiétant. Cela est symbole d’un besoin urgent de redéfinir les priorités. Chez certains, la panique les pousse vers un État tout-puissant, prêt à tout régenter et planifier jusqu’au moindre lampadaire ; d’autres, épris d’un libéralisme forcené, laisseraient purement et simplement le marché tracer sa route, quitte à délaisser, sur les bas-côtés, les plus humbles. Pour ma part, je défends un libéralisme coopératif, où l’action publique s’allège et se recentre, sans jamais abandonner ceux qui en ont besoin.
Que faut-il entendre par là ? Ce n’est ni un Léviathan bureaucratique, ni un espace livré à la seule loi du profit, mais un modèle de collaboration raisonnée, autant que raisonnable, entre communes, entreprises, associations et citoyens. Collaboration dans laquelle l’État cantonal cesse de vouloir tout encadrer. Depuis plusieurs années, la mode est à la « planification » sous toutes ses formes, recouverte d’un vernis d’expertise technocratique souvent trop uniforme pour tenir compte des diversités locales. On s’imagine que le Conseil d’État pourrait, à coup de lois et de règlements, dicter la même marche à suivre à une commune alpine, à un bourg viticole ou à un village de la Broye. C’est faire fi de la richesse du terrain, du bon sens des élus de proximité et des acteurs économiques de chaque région.
Faire confiance aux acteurs de terrain
Le libéralisme coopératif que je propose s’articule autour d’une idée maîtresse : l’État doit se borner à définir quelques grands objectifs communs, tels que la solidarité envers les plus fragiles, la préservation de l’environnement, la gestion pérenne des finances, tout en laissant le soin aux municipalités, aux entreprises et aux collectifs d’initiatives locales de concevoir et mettre en œuvre des solutions concrètes. S’agirait-il de bâtir un écoquartier, de moderniser une infrastructure culturelle ou d’améliorer un service social ? Plutôt que d’accumuler les procédures au sommet, on ferait confiance aux acteurs de terrain pour expérimenter, coopérer et ajuster.

Ne nous y trompons pas : l’État, même allégé, ne disparaîtrait pas pour autant. Il conserverait un rôle de garant de l’intérêt collectif, prompt à intervenir si une situation devenue trop inégale menaçait les plus démunis. Il garderait la main sur un mécanisme de péréquation, afin de ne pas laisser les communes moins favorisées au bord de la route. Tout comme il fixerait des règles minimales pour éviter des dérives en matière de travail ou d’urbanisme, par exemple. Cependant, il délaisserait la manie de la surplanification, ces fameuses injonctions à tout prévoir, tout chiffrer, tout figer.
Des normes kafkaïennes
Certains esprits chagrins y verront la porte ouverte à l’anarchie ou à l’injustice. Bien au contraire : en allégeant l’appareil prescriptif, on libère les énergies et l’ingéniosité. Il faut bien le constater, bien des projets sont actuellement étouffés dans l’œuf par des normes kafkaïennes et des délais administratifs interminables. La décentralisation d’une partie des décisions, quitte à expérimenter des méthodes nouvelles, favoriserait la participation citoyenne. C’est ainsi que l’on redonne du sens au débat communal, où chacun peut exposer ses propositions et trouver des partenaires, que ce soient des associations ou des entrepreneurs locaux.
Prenons l’exemple de la transition énergétique. Aujourd’hui, le canton édicte des directives si spécifiques que certaines communes, pourtant motivées, n’osent plus prendre d’initiatives. Avec le libéralisme coopératif, la mission de l’État se résumerait à fixer un horizon, à fournir un accompagnement technique de base et à encourager la mutualisation des retours d’expérience. La mise en place concrète, création de coopératives solaires, partenariats avec des PME spécialisées, etc., relèverait des municipalités et du tissu économique local. Les habitants, impliqués directement, y gagneraient un sentiment d’appropriation, loin des directives tombées du ciel administratif.
Cette souplesse n’exclut pas un filet de sécurité pour ceux qui, devant les transformations, risquent de sombrer dans la précarité. Des allocations, un accompagnement social, une accessibilité aux services publics : voilà autant d’éléments que le canton doit garantir en dernier recours. Encore une fois, nul besoin de pondre une énième grande réforme globale ; mieux vaut confier aux responsables de terrain la tâche de cibler, d’adapter, de coordonner. Trop de programmes sociaux se sont enlisés parce qu’on entendait tout imposer depuis le centre, sans considérer les spécificités de chaque localité.
Message important !
Cette tribune vous est offerte mais nous avons besoin de vous pour continuer à jouer notre rôle d’empêcheur de penser en rond.
Abonnements : https://lepeuple.ch/sabonner/
Dons : https://lepeuple.ch/nous-soutenir/
Dans ce schéma, le partenariat public-privé ne se réduit pas à une externalisation sauvage. Les entreprises, encouragées par des allègements fiscaux ou des incitations intelligentes, s’investiraient dans des missions d’intérêt général, telles que la création de logements abordables, la modernisation des réseaux d’eau communaux ou encore le soutien à la formation professionnelle. L’État poserait quelques balises (transparence, respect des salariés, critères environnementaux) plutôt que de tout exécuter lui-même. À terme, cela peut alléger les finances cantonales et, bien mieux, démultiplier l’impact des projets, sans renier la dimension sociale.
Renoncer à la tentation du « tout-prévoir »
Bien sûr, une telle doctrine n’est pas exempte de défis. Elle demande de la part du Conseil d’État un certain courage politique : renoncer à la tentation du « tout-prévoir », assumer l’idée qu’une région évolue parfois plus vite qu’une autre, accepter une forme d’émulation entre communes. Elle sollicite également un sens civique renouvelé, car les habitants et les élus locaux ne pourront plus se retrancher derrière la fatalité d’une législation trop lourde. Ils devront s’emparer des outils mis à disposition pour forger leurs propres solutions.
C’est précisément dans ce sursaut de responsabilité partagée que réside l’essence du libéralisme coopératif : une voie qui ne délaisse pas les plus vulnérables, tout en accordant à la société la liberté de s’organiser de manière plus flexible, plus ingénieuse. N’est-ce pas, au fond, dans l’ADN de notre canton ? Pourquoi ne pas opter pour cette voie vertueuse afin de redonner des couleurs à nos finances et un nouveau souffle à notre vie politique ?
Puissions-nous, dans le choix de nos réformes et dans l’orientation à donner à l’État, avoir la sagesse de ne point céder aux démons de la surplanification, qui étouffe toute spontanéité. Une voie plus sobre, laissant respirer l’action locale et encourageant la collaboration mutuelle, pourrait bel et bien nous tirer de l’impasse financière actuelle, tout en respectant la dignité de chacun, y compris les plus humbles.
À lire aussi: https://lepeuple.ch/tout-pouvoir-meme-cantonal-a-besoin-dun-garde-fou/