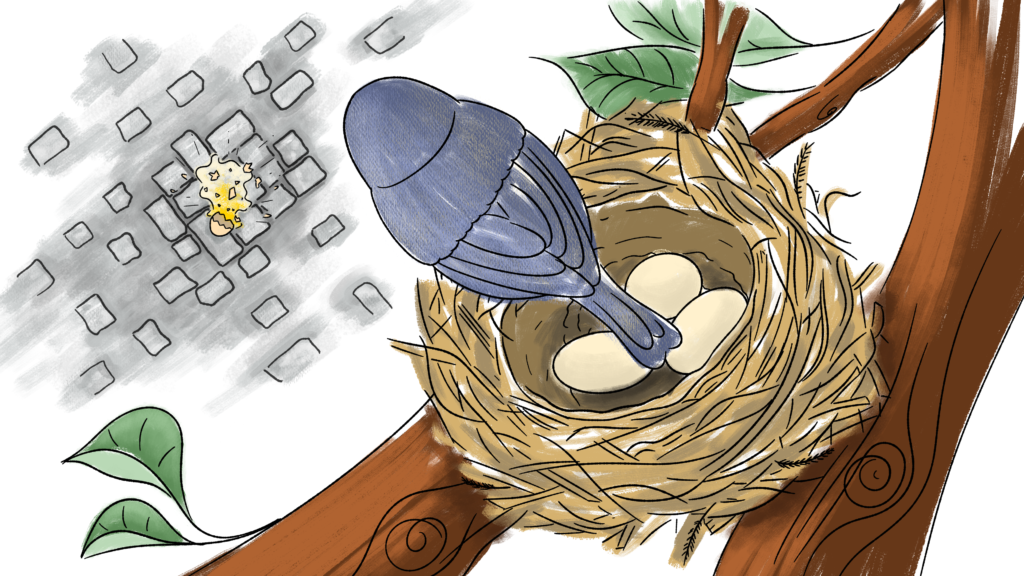Mater Dolorosa 5/5 – Donner corps au deuil
« Dieu est digne de louanges en tout temps », avait répondu le pasteur de Marie-Laure, alors qu’elle venait auprès de lui pour trouver du réconfort suite à deux pertes de grossesses consécutives. « Cela a ébranlé ma foi d’une manière inimaginable et j’ai mis très longtemps à la concilier avec ces deux pertes.» « Natacha, quant à elle, s’est sentie mieux écoutée, autant par son pasteur que par son épouse. Elle souligne « une grande conscience de la souffrance vécue, beaucoup de compassion et un vrai suivi ». Ce dont beaucoup de femmes ne bénéficient pas. Une fois la souffrance déposée l’entourage, tout autant que les ministres du culte, s’attendent souvent à ce que vous alliez vite mieux.
La théologienne Elise Cairus, spécialiste de l’accompagnement spirituel des naissances difficiles, le confirme. « Les pasteurs ne sont pas outillés pour accompagner ces situations de vie » et aussi mal à l’aise que le reste de la société vis-à-vis de thématiques confrontantes comme la mort d’un enfant à naître. « Pastoralement et spirituellement, on accompagne le deuil, la fin de vie, la maladie, mais quasiment jamais la naissance », constate-t-elle. Un point de vue que ne partage pas Céline, maman d’un bébé décédé in-utero à sept mois de grossesse et engagée professionnellement pour l’Eglise dans le canton de Vaud. « L’Eglise, en tant que spécialiste de la mort, à sa place dans les moments de « l’aigu » qui se vivent dans le cadre hospitalier. Ce n’est pas à l’institution ecclésiale d’assurer le suivi, mais elle devrait ventiler vers les associations. Dans ce genre de situations, nous avons besoin de quelqu’un de spécialisé en la matière. Pour ma part, je n’ai pas envie que les Eglises me proposent ce que je peux trouver seule sur internet ».
De rares propositions d’accompagnements
« N’étant dans le canton de Vaud que depuis peu et moins directement impliqué dans ces questions que les accompagnants spirituels référents des services concernés, j’avoue ne pas avoir connaissance de propositions d’accompagnement spécifiques en milieu ecclésial », reconnaît Jean-Noël Theurillat, responsable de l’aumônerie au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Même son de cloche du côté de l’aumônerie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), tous deux interrogés sur les relais ecclésiaux existants à l’extérieur du cadre hospitalier. Qu’en est-il des faîtières catholiques (Cath) et réformées (Réf) des cantons romands (GE, VD, FR, NE, VS, JU) ? Existe-il en leur sein des lieux ou des personnes spécifiquement formées pour accompagner les situations de pertes de grossesses ?
A l’heure de la publication de cette enquête, la moitié des faîtières interrogées a répondu aux sollicitations (GE Cath/Réf, NE Cath, VS Cath, JU Cath/Réf). Parmi les réponses reçues, seule une proposition d’accompagnement des pertes de grossesses existe dans le Jura. Par ailleurs, une offre d’accompagnement de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) a été repérée par un autre biais. La même requête a été soumise à certaines communautés évangéliques. Les institutions cantonales ne possédant pas d’accompagnement spécifique ont réagi diversement à cette interpellation. « L’accompagnement, peut être facilité via l’aumônerie de la santé – lors d’un décès en milieu hospitalier – ou à travers un lien particulier avec un prêtre mais malheureusement nous sommes faibles et démunis sur cette question », écrit le porte-parole de l’Eglise catholique Neuchâteloise. Ou encore : « Les ministres qui travaillent à l’EPG, que ce soit en aumônerie ou dans les paroisses, sont formés à accompagner toute personne, quelle que soit la nature de sa détresse. Ils et elles répondent en ce sens à une nécessité de polyvalence et de disponibilité […] », répond l’Eglise protestante de Genève.
En Valais, la responsable de la pastorale des couples et des familles du Diocèse de Sion s’exprime en ces termes : « A ce jour, lorsque nous apprenons qu’une famille est touchée, nous nous permettons d’envoyer une lettre et de proposer un accompagnement professionnel, notamment avec l’association Astrame ou via un couple formé qui a traversé cette épreuve. En nous mettant à l’écoute des personnes endeuillées, plus particulièrement de jeunes enfants, nous avons compris que les personnes sont vraiment demandeuses d’un accompagnement professionnel. […] De manière générale on constate une grande souffrance et un repli sur soi en début de deuil. C’est très difficile pour les personnes d’oser chercher de l’aide, et ce n’est pas forcément vers l’Eglise qu’elles se tournent ».
Recherche de sens primordiale
Pourtant, « cela fait partie de l’accompagnement que les Eglises doivent proposer », estime Alice, une vaudoise qui a elle-même vécu deux pertes de grossesse précoces en 2020. Elle mentionne le soutien prodigué par l’équipe investie dans le projet de l’EERV, Des étoiles dans le cœur, qu’elle considère « très précieux », car il apporte une dimension supplémentaire par rapport aux soins psychothérapeutiques : celle de la spiritualité et de la recherche de sens lors d’un événement qui tient de l’inconcevable.

« Il n’y a pas d’espaces pour l’échec et l’inabouti dans notre société », explique Liliane Rudaz-Kagi, diacre de l’EERV et membre de l’équipe pastorale œuvrant pour Des étoiles dans le cœur. « C’est comme si on ne faisait « rien » de cet événement de vie, alors que la question de sens est primordiale et peu investie dans les autres types d’approches ». Le projet s’adresse « aux personnes ayant vécu la perte d’un ou plusieurs bébés durant la grossesse, lors des premiers temps de vie ou dont le désir d’enfant ne s’est pas réalisé pour d’autres raisons ». Qu’il soit question de pertes de grossesses (spontanées ou volontaires) ; d’aide à la décision quant à une interruption volontaire ou thérapeutique de grossesse (IVG et ITG) ; d’accompagnement dans le processus de deuil ; de demande de rituel laïc ou religieux, « les intervenantes ont toutes une trajectoire de vie leur permettant de mieux rejoindre le vécu et les attentes des personnes se tournant vers elles ».

Reconnaître la souffrance des personnes qu’elles accompagnent, c’est aussi sensibiliser ceux qui prennent en charge ces femmes quotidiennement : les membres du personnel médical. Les intervenantes ont donc cherché à contacter les gynécologues de la région lausannoise pour attirer leur attention sur cette intime et délicate question, « mais avec certains, il est impossible d’entrer en dialogue », déplore Liliane Rudaz-Kagi. Elle signale aussi le camouflet infligé par les doyens de la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne (UNIL), qui forment les futurs gynécologues et ceux de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), dans laquelle sont formées les sages-femmes. « Nous leur avons proposé un petit module de sensibilisation au deuil périnatal élaboré par nos soins. Nous avons reçu un refus net de leur part, au motif que les soignants y étaient déjà préparés et que le cursus de formation était déjà trop chargé. »
Déposer la souffrance
Dans le Jura, c’est une initiative œcuménique qui a vu le jour en 2022. L’élan de départ est né dans un cadre surprenant, puisqu’il a émané d’aumôniers de maisons de retraites qui ont constaté que la perte d’un enfant durant la grossesse ou à la naissance était un traumatisme qui perdurait jusqu’à la fin de la vie des personnes concernées. Cette observation a travaillé Philippe Charmillot, diacre pour le Jura pastoral. « J’ai réalisé le désarroi et la solitude de ces parents et cette thématique est devenue mon cheval de bataille. »

Avec ses homologues réformés, il a pris à bras le cœur la condition de ces parents endeuillés, quel que soit le stade de grossesse. « Nous avons mis sur pied un groupe œcuménique et pluridisciplinaire pour y réfléchir, composée de pasteures réformées, d’un diacre catholique, d’une sage-femme et de parents ayant vécu un deuil », complète Florence Hostettler, pasteure pour la région de Porrentruy. Le groupe de travail s’est d’abord attelé à organiser une conférence avec la psychologue et auteure Florence d’Assier de Boisredon en octobre 2022, puis deux célébrations œcuméniques à la Chapelle de l’Unité de Develier-Dessus, en octobre 2022 et 2023, pour permettre aux familles touchées par un deuil périnatal de vivre un temps de recueillement et de poser un geste symbolique. Ils ont ensuite disposé dans cette même chapelle une montgolfière en bois sur laquelle les parents peuvent « déposer » tout au long de l’année ce qu’ils souhaitent.
En outre, un numéro de téléphone permettant de joindre l’équipe pastorale œcuménique a été mis à disposition par le biais d’affichettes dans les cabinets de gynécologie du canton ainsi qu’à l’hôpital de Delémont, permettant aux parents de trouver informations et réconfort. Philippe Charmillot constate ne pas avoir reçu d’appels depuis que la ligne est en service. « Soit c’est un signe que ce qui a été mis en place porte ses fruits, ou au contraire, un indice supplémentaire de la difficulté à faire évoluer les mentalités sur cette question ». Les ministres et diacres jurassiens ont interpellé les médias de la région dans l’intention de sensibiliser le plus de monde possible.
Un besoin abyssal
De l’autre côté de la frontière, la situation est inverse. « Les femmes se bousculent », que cela soit pour un accompagnement individuel, un suivi de groupe ou les formations en ligne. « Le besoin est abyssal » et la liste d’attente ne diminue jamais, indique Sandra Dubi, pasteure au Gospel Center d’Annecy, une église de sensibilité évangélique. Psychologue, titulaire d’un diplôme de l’Université de Lausanne (UNIL), elle a développé en 2005 avec son mari, aussi pasteur, un ministère (Zoah) psycho-spirituel qui propose un soutien face aux pertes et crises de grossesse. Alors que cette thématique n’éveille encore aucun intérêt au sein de la société, si ce n’est chez les femmes touchées, Sandra Dubi perçoit déjà que « ces enfants invisibles peuvent « poursuivre » les mères toute une vie et provoquer chez elles des « nœuds » difficiles à dénouer ».

« Une perte, quelle qu’elle soit, engendre toujours une douleur », annonce d’emblée la pasteure, raison pour laquelle « nous les considérons et les accompagnons sans discrimination. Nous partons du postulat qu’une femme pourrait avoir besoin d’être accompagnée tant dans le cas d’une fausse couche que dans celui d’une interruption volontaire ou thérapeutique de grossesse ». Pour Sandra Dubi, dans un cas de figure comme dans l’autre, « il est impératif de dire « au revoir » à cet enfant pour accueillir le suivant ». En parallèle, le couple de pasteurs propose un module de formation en ligne qui s’adresse à leurs confrères et aux conseillers en relation d’aide pour les sensibiliser à cette thématique. « Il permet de développer une perspective globale sur les pertes de grossesse, fausses couches, interruption volontaire ou thérapeutique de grossesse (IVG, ITG) et donne des outils concrets pour aider les femmes et leurs partenaires confrontés à une telle crise. Ce module de formation participe à renouveler la réflexion sur des sujets comme les origines de la vie, la contraception, le déni, l’adoption ou encore les interruptions de grossesse ». Car selon Sandra Dubi, « la plupart des pasteurs ne sont pas outillés à accompagner ce type de problématiques et même dans la relation d’aide classique, la perte de grossesse n’est pas toujours prise en considération ».
Ces accompagnements et formations sont destinés à un public croyant « ou du moins sympathisant » et la pasteure est claire sur ce point. D’ailleurs, pour que ne subsiste aucune ambiguïté, il est demandé aux personnes intéressées de lire un petit fascicule détaillant en quoi consiste la démarche d’accompagnement et les conceptions qui la sous-tendent. Mais cette mesure ne décourage en rien les postulantes, prêtes à traverser la frontière pour bénéficier d’un tel accompagnement. Le Gospel Center d’Yverdon-les-Bains, une église sœur de celle d’Annecy, a aussi périodiquement organisé des suivis de groupes pour répondre à la demande.
Outre ce ministère à visée « de guérison et de restauration », Sandra Dubi se bat « pour réveiller l’Eglise », car cette thématique est aussi du ressort de toute la communauté chrétienne. Elle souhaite pour ce faire « éduquer les chrétiens à faire leur travail de « chrétiens » autour d’eux ». Une vision partagée par l’aumônier au CHUV Jean-Noël Theurillat: « L’importance d’un accueil inconditionnel et pleinement investi devrait être de la conscience de chacun ».
Relâcher l’enfant vers le Père
Concrètement, toutes ces démarches d’accompagnements trouvent des points de convergences. Autant Liliane Rudaz-Kagi que Sandra Dubi évoquent l’importance de la parole. « Délier la langue amène à sortir du déni et de la culpabilité », illustre la pasteure du Gospel Center d’Annecy. Verbaliser permet aussi de prendre conscience de la gravité que peut engendrer un deuil non résolu. « Des difficultés avec un vécu du passé peuvent ressurgir à l’occasion d’une nouvelle grossesse », développe la diacre de l’EERV.
« Ce processus de guérison nécessite une réhabilitation profonde, car il faut prendre conscience que ce n’est pas une restauration du mental qui est en jeu, mais une réappropriation de son corps », affirme Ghislaine Pugin, sage-femme libérale dans le canton de Vaud spécialisée dans l’accompagnement du deuil périnatal. « Les accompagnements peuvent être très longs, et parfois durer plusieurs années. » Il demeure donc primordial de prendre le temps nécessaire à la résolution du deuil en ne remettant pas « rapidement le pied à l’étrier », au contraire de ce que préconisent certains praticiens, et en dissociant chacune des grossesses, afin d’éviter ce que l’on nomme le « syndrome de l’enfant de remplacement ».
Ces démarches proposent, par exemple, un mouvement d’appropriation/relâchement, en donnant premièrement un prénom à l’enfant perdu, ce qui le rend ainsi irremplaçable. Certaines mères ont aussi associé le fait de nommer l’enfant à un objet souvenir : un bracelet gravé avec des initiales, une paire de chaussons tricoté, un pyjama, etc. Il s’agit « d’honorer la vie et la valeur de cet enfant pour mieux le relâcher vers le Père », décrit Sandra Dubi. Un rituel de séparation est parfois nécessaire, non seulement « pour poser un geste « d’adieu » ou « d’à Dieu » », commente Philippe Charmillot. Paradoxalement, il fait exister et rend visible un être qui n’a souvent laissé de souvenirs que dans la chair de la mère. Pour reprendre les propos d’une des mamans, c’est une manière de matérialiser, « ces enfants qui nous traversent, mais que l’on n’oubliera jamais ».
- Prologue : https://lepeuple.ch/mater-dolorosa/
- Épisode 1 : https://lepeuple.ch/1-6-treize-semaines-sinon-rien/
- Épisode 2 : https://lepeuple.ch/mater-dolorosa-2-5-maux-compte-triple/
- Épisode 3 : https://lepeuple.ch/mater-dolorosa-3-5-un-deuil-fantome/
- Épisode 4 : https://lepeuple.ch/mater-dolorosa-4-5-deni-de-misericorde/