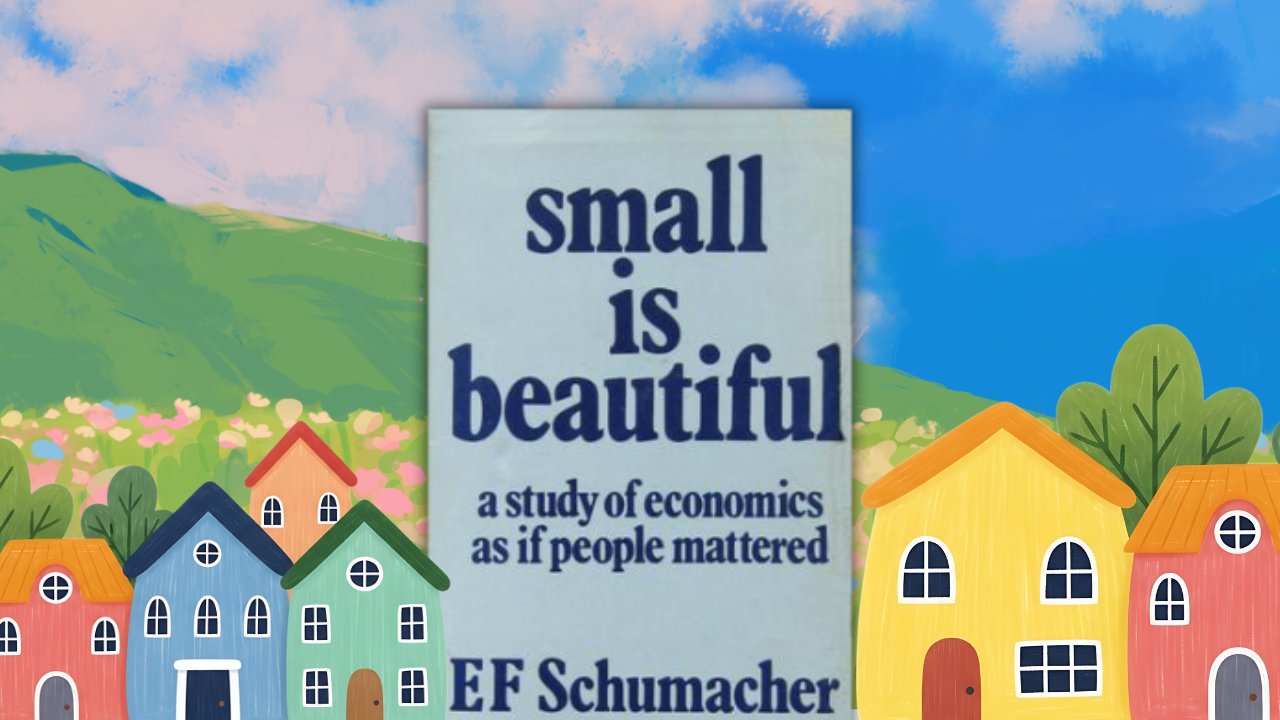Publié en 1973, Small is Beautiful – Une société à la mesure de l’homme d’E. F. Schumacher fut lu d’abord comme un manifeste écologique, écrit au lendemain des chocs pétroliers. Cinquante ans plus tard, il revient à nous comme une prophétie. Car si le décor a changé, la maladie demeure : mégaserveurs numériques qui engloutissent nos vallées d’énergie, hôpitaux régionaux réduits à des lignes budgétaires, Europe contrainte de légiférer pour que l’on puisse seulement réparer une bouilloire ou un smartphone. Une question traverse ces turbulences : à quelle échelle l’homme peut-il encore être responsable ?
Le mal moderne : la démesure
Dès les premières pages, Schumacher ne parle pas d’économie mais de morale. Là où tant d’experts entassent des chiffres, il ose une condamnation spirituelle.
« L’idée qu’une civilisation puisse se maintenir sur la base d’une telle transgression est une monstruosité morale, spirituelle et métaphysique. Cela revient à conduire les affaires économiques de l’humanité comme si les hommes n’avaient aucune importance » (Une technologie à visage humain, p. 107).
Cette transgression n’est pas un simple excès de calcul. C’est une faute métaphysique : croire que l’on peut user la nature comme une caisse sans fond, convertir l’héritage en rente, vivre dans l’illusion d’une abondance infinie. Et quand il ajoute : « La technologie ne reconnaît aucun principe d’autolimitation — par exemple quant à la taille, la vitesse ou la violence » (p. 107), il décrit notre siècle mieux que nous ne savons le faire. Car la modernité s’est enivrée de sa propre puissance. Elle a oublié qu’un pouvoir qui ne connaît pas ses bornes finit toujours par se retourner contre celui qui le manie.
Faire son miel de toute fleur !
Exceptionellement, ce texte vous est offert dans son intégralité ; mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à jouer notre rôle d’empêcheurs de penser en rond.
Abonnements : https://lepeuple.ch/sabonner/
Dons : https://lepeuple.ch/nous-soutenir/
Acheter notre manuel de survie médiatique (9.90 CHF) : https://lepeuple.ch/librairie-du-peuple/
Quand les chiffres deviennent des abîmes
Les chiffres tombent — non comme des abstractions, mais comme des verdicts. Les centres de données européens engloutissaient déjà 96 TWh en 2024. Ils en dévoreront 168 TWh en 2030, puis 236 TWh en 2035(Ember, 2025). En Suisse, pays de barrages et de vallées étroites, l’équilibre patiemment bâti menace de se rompre : ces forteresses numériques pourraient, dans dix ans, accaparer jusqu’à 15 % de la demande nationale. Et l’Agence internationale de l’énergie, implacable, annonce 945 TWh à l’échelle mondiale en 2030, soit près de 3 % de toute l’électricité terrestre.
Ces courbes dessinent des paysages : des cathédrales renversées où ne brûle plus qu’une flamme, celle de la consommation électrique. Bientôt des villages où l’eau circulera pour les serveurs plus que pour les habitants. Bientôt des communes contraintes de plier leur budget d’infrastructure à ces colosses.
Schumacher avait prévenu : « Tout à l’excitation que lui procure la démonstration de ses pouvoirs scientifiques et techniques, l’homme moderne a construit un système de production qui viole la nature et un type de société qui mutile l’homme » (Épilogue, p. 303).
La démesure technique se paie d’une mutilation sociale.

La réparation comme dignité retrouvée
Et pourtant, tout n’est pas livré au fatalisme. Il est des résistances discrètes, presque modestes, mais décisives. L’Union européenne, en 2024, a voté une directive sur le « droit à réparer », applicable en 2026. Les fabricants devront fournir les pièces de rechange, prolonger la durée de vie des appareils, lever les obstacles logiciels.
Certains hausseront les épaules : détail technique. Non. Réorientation morale. Car, écrivait Schumacher : « La tâche première de la technologie est apparemment d’alléger le poids du travail auquel l’homme est astreint… Lorsque le travail manuel productif exige l’adresse et sollicite la créativité, il apporte joie et dignité » (p. 109-110).
Réparer n’est pas perdre son temps. C’est redonner à l’homme sa place de sujet. C’est refuser l’esclavage de l’obsolescence programmée. C’est transmettre un geste qui unit les générations, un geste humble mais souverain.
L’épreuve vaudoise : quand la santé se réduit à un tableau Excel
Été 2025. Le Conseil d’État vaudois annonce vingt millions de coupes dans les Prestations d’intérêt général des hôpitaux régionaux. Jusqu’à 25 % pour certains établissements. Les chiffres s’alignent comme des couperets. Mais le Grand Conseil se lève en bloc et l’exécutif recule partiellement.
On aurait tort d’y voir un banal bras de fer budgétaire. C’est une bataille d’échelle. Car un hôpital régional n’est pas une cellule Excel. C’est une salle de garde de nuit, une main posée sur une épaule, un jeune médecin formé dans le tumulte des urgences. C’est un lieu où la responsabilité a un visage.
Schumacher l’avait écrit, presque prophétique : « Nous pouvons déjà prévoir, à mon avis, le conflit d’attitudes qui décidera de notre avenir. D’un côté, je vois ceux qui pensent pouvoir faire face à notre crise avec les méthodes actuelles, sinon de plus poussées… De l’autre côté, se trouvent ceux qui, en quête d’un nouveau style de vie, cherchent à revenir à certaines vérités élémentaires relatives à l’homme et à son univers » (p. 114-115).
C’est ce conflit que nous vivons ici même, dans nos institutions cantonales : entre la froideur des agrégats et la vérité du soin de proximité.
Le « petit » comme règle de discernement
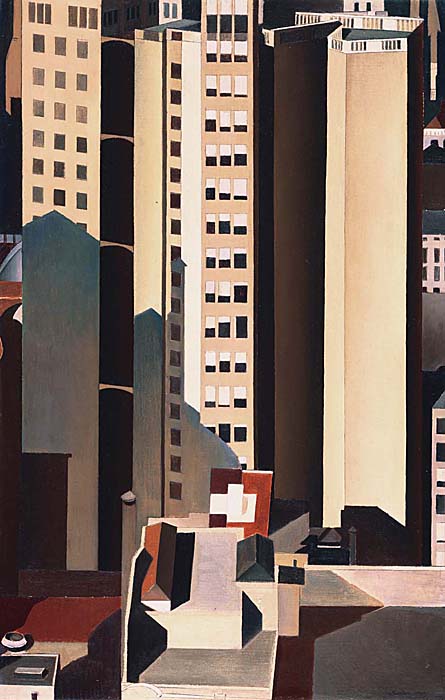
Vision glaciale du gigantisme américain : une architecture sans visages, où l’échelle même des bâtiments écrase toute présence humaine. Une illustration saisissante de la démesure moderne décrite par Schumacher.
On a souvent caricaturé Schumacher en apôtre nostalgique d’un retour au village. Mais il ne plaide pas pour l’archaïsme : il propose une maxime de prudence.
« L’homme est petit ; donc, tout ce qui est petit est bel et bon » (p. 113).
Le « petit » n’est pas un fétiche, mais une condition. Ce qui est à taille humaine peut être compris, gouverné, réparé. Ce qui dépasse cette mesure devient abstraction — et l’abstraction finit par écraser l’homme.
C’est pourquoi il cite Gandhi : « production par les masses plutôt que production de masse » (p. 111). Produire avec les hommes, plutôt que contre eux. Multiplier les capabilités locales au lieu de concentrer les dépendances globales.
Le travail comme lieu de dignité
Schumacher insiste avec une force singulière : « Dans une économie où le but est de réduire le travail humain, il y aura inévitablement du chômage, de la frustration, et du gaspillage des ressources humaines. Dans une économie où le but est de donner aux gens la possibilité de travailler de façon intelligente, créative et utile, il y aura dignité et paix » (p. 75-76).
Ces lignes traversent les décennies et nous rejoignent. Car nous rêvons aujourd’hui d’algorithmes enseignants, de protocoles hospitaliers impersonnels, de justice automatisée. Mais une société qui méprise le travail concret méprise l’homme.
Schumacher avait vu que l’homme spectateur des machines deviendrait un homme frustré. La paix ne viendra pas de l’abolition du travail, mais de sa dignité retrouvée.
Une conclusion spirituelle
Le livre se termine par une question simple, à la fois désarmante et exigeante : « Partout, on demande : que puis-je réellement faire ? La réponse est aussi simple que déconcertante. Nous pouvons, chacun d’entre nous, travailler à faire régner l’ordre en nous-mêmes… Les conseils dont nous avons besoin ne peuvent pas nous être fournis par la science ou la technologie… Mais on peut encore les trouver dans la sagesse traditionnelle de l’humanité » (Épilogue, p. 304).
On referme ces pages comme on quitte une église après un sermon : en silence. La juste échelle n’est pas une formule technique, mais une discipline intérieure. Elle commence dans l’âme avant de se prolonger dans les institutions.
Dans un village, c’est une école qu’on maintient malgré les chiffres. Dans un hôpital, un service de nuit qu’on garde malgré le déficit. Dans une maison, un objet qu’on répare plutôt que de jeter. Dans une commune, un élu qui accepte de rendre des comptes à hauteur de regard.
On dira que c’est peu de choses. Et pourtant, c’est là que se joue l’essentiel. L’homme est petit ; donc, tout ce qui est petit est bel et bon. On peut sourire de la naïveté de cette maxime. Mais dans le tumulte numérique, énergétique, budgétaire, elle brille comme une lampe fragile.
L’avenir ne dépendra pas de systèmes colossaux, mais de cette fidélité humble à la proportion : un geste accompli, une parole tenue, un visage reconnu. Ce n’est pas la démesure qui sauvera l’homme, mais ce qui demeure à sa taille.
E. F. Schumacher, Une société à la mesure de l’homme – Small is Beautiful, traduction de Marc B. de Launay, 1978, coll. Points Essais.

Sur la monstruosité morale de l’économie moderne
« L’idée qu’une civilisation puisse se maintenir sur la base d’une telle transgression est une monstruosité morale, spirituelle et métaphysique. Cela revient à conduire les affaires économiques de l’humanité comme si les hommes n’avaient aucune importance. » (Une technologie à visage humain, p. 107)
Sur l’absence de limite de la technique
« La technologie ne reconnaît aucun principe d’autolimitation — par exemple quant à la taille, la vitesse ou la violence. » (Une technologie à visage humain, p. 107)
Sur la règle de la proportion
« L’homme est petit ; donc, tout ce qui est petit est bel et bon. » (Une technologie à visage humain, p. 113)
Sur le rôle du travail
« Lorsque le travail manuel productif exige l’adresse et sollicite la créativité, il apporte joie et dignité. » (Une technologie à visage humain, p. 110)
Sur la responsabilité personnelle
« Partout, on demande : que puis-je réellement faire ? La réponse est aussi simple que déconcertante. Nous pouvons, chacun d’entre nous, travailler à faire régner l’ordre en nous-mêmes. » (Épilogue, p. 304)