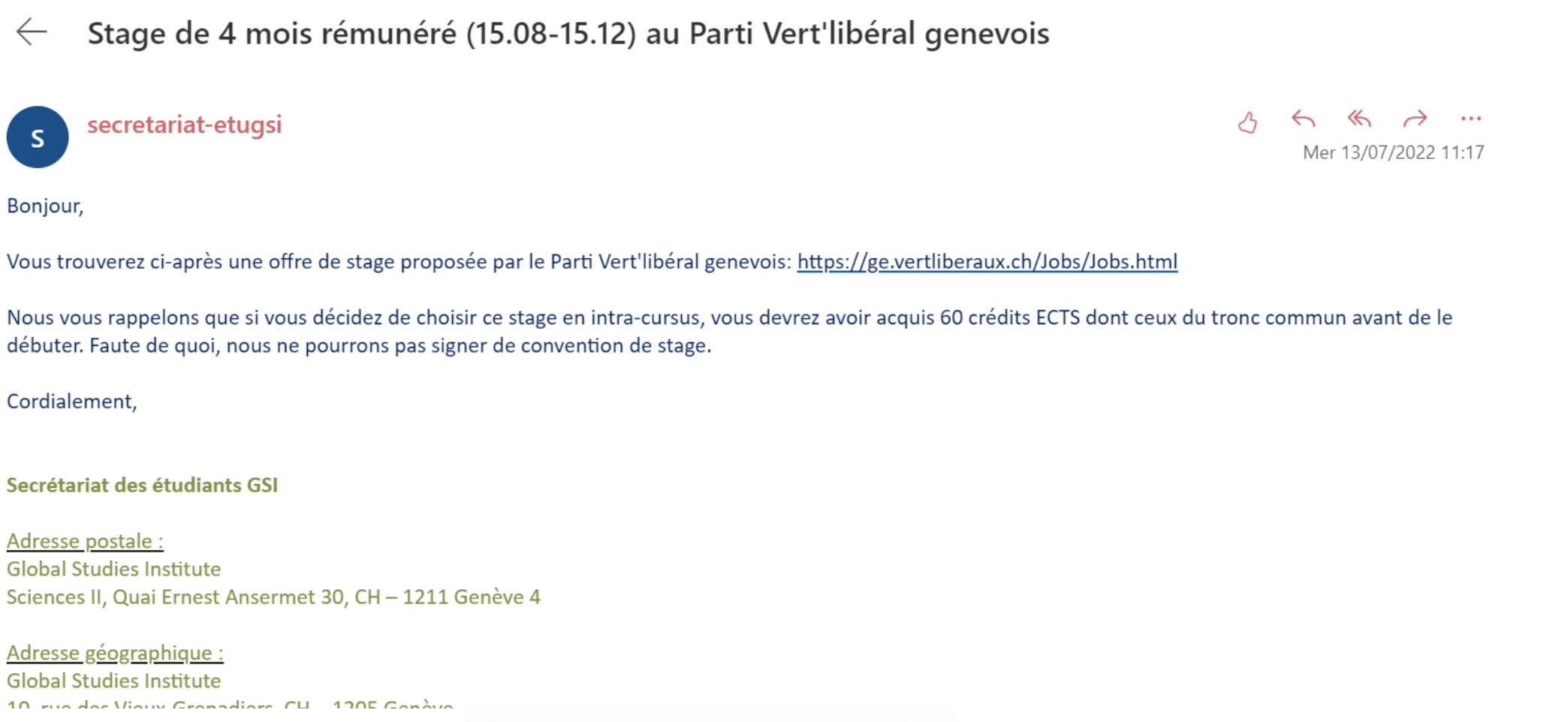Dans le Nord vaudois, les déboires de La Casba font bientôt partie du folklore régional, au même titre que le retour automnal du Vacherin Mont-d’Or ou les psychodrames de la classe politique yverdonnoise. Situé sous la Croix du Cochet, entre Sainte-Croix et Les Rasses, ce petit établissement isolé fait face depuis 2019 à toute une série de demandes des autorités cantonales: rénovation de la cuisine en 2020 (45’000 francs), installation d’une tranchée filtrante pour l’épuration des eaux ou mise en place d’une protection incendie digne de ce nom, dès que possible (100’000 francs). Des mesures auxquelles les gérants, Roger et Nicole Félix, s’efforcent de faire face grâce à leurs amis et à la solidarité des amoureux de ce petit coin de paradis. «Ce qui m’y a immédiatement plu, c’est l’aspect isolé, la tranquillité», se souvient Roger, qui prévoyait sans doute une retraite moins rocambolesque en reprenant ces lieux connus pour le menegetz, boisson emblématique à base de kirsch.
Le clou du spectacle
Car depuis le mois de mars, une énième demande de la Police cantonale du commerce (PCC) reste en travers de la gorge des tenanciers. Alors que les plus grandes écoles et institutions artistiques – à supposer qu’il faille les départager – du canton de Vaud se vantent désormais de «dégenrer» leurs WC pour garantir plus d’inclusivité, un architecte qui travaille bénévolement pour la cabane a reçu l’ordre… de prévoir des toilettes séparées, hommes et femmes, au lieu du modeste espace actuel situé au bout d’un couloir. Un lieu qui n’a pourtant jamais dérangé personne durant des décennies. Alors rien de dramatique, certes, mais tout de même une surprise un peu désagréable de la part d’un canton qui exige déjà des travaux extrêmement importants dans toute une série de domaines. «J’ai le sentiment que la Police du commerce est en retard d’une guerre», se lamente Roger. «On fait des WC mixtes partout, mais nous nous devrions faire l’inverse. Il y a de quoi se demander s’il n’y a pas une forme d’acharnement contre nous.» L’homme fait état de rapports bien plus chaleureux avec le chimiste cantonal. Il se dit d’ailleurs conscient que les uns et les autres font simplement leur travail, mais avec plus ou moins de rondeur humaine.
«Profondément écologiste», Roger ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondé de la majorité des demandes des autorités, et notamment la nécessité d’une tranchée filtrante. Seulement, pour les payer, le retraité aimerait bien pouvoir faire tourner la boutique au lieu, comme maintenant, de devoir accueillir les visiteurs «en amis», comme le souligne le site internet des lieux. Mais sur cet objet, le canton ne dira rien: «Une procédure est en cours auprès du Tribunal cantonal, de sorte que nous ne pouvons pas renseigner sur une procédure en cours», tranche Denis Pittet, délégué à la communication du Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine.
Reste le cas de ces fameuses toilettes, il est vrai bien modestes, mais à l’image des lieux. N’y a-t-il pas quelque chose de grotesque à appliquer des règles aussi strictes pour un établissement qui, en dehors de toute idéologie, s’inscrit tout bonnement dans la réalité du terrain? «Les exigences de la Police cantonale du commerce, formulées lors de la procédure de mise à l’enquête qui a abouti sans contestation des exploitants, sont fondées sur le cadre légal applicable», poursuit Denis Pittet. Avec une précision: «Cet article a fait l’objet d’une récente intervention parlementaire. Un projet de révision de cet article a été préparé et sera soumis prochainement au Conseil d’État. Si le projet aboutit, il ne sera plus exigé de toilettes genrées dans les établissements.» On ignore s’il faut s’en réjouir dans l’absolu, mais voilà déjà un embryon de bonne nouvelle en ce qui concerne les intérêts de La Casba.
Les effets pervers de la centralisation étatique
Et si, finalement, les démêlés de Roger Félix n’illustraient pas les effets pervers d’une trop forte tendance à la centralisation? C’est ce que disent bon nombre d’habitants du Balcon du Jura. Même le syndic de Sainte-Croix, Cédric Roten, admet parfois faire face à des surprises administratives avec des demandes pourtant basiques, mais dont la réalisation occasionnerait des frais de plusieurs centaines de milliers de francs pour la commune. «Il y a parfois un manque de contextualisation dans l’application de certaines règles», juge-t-il, prudent. Entre les lignes, on découvre des autorités communales qui, comme le petit exploitant d’une cabane, font face à des armées de juristes dont la fonction consiste désormais à couvrir des centres de décision très souvent déconnectés du terrain.
«Ma situation est celle d’un simple péquin qui fait tout pour survivre face à une administration qui ne tient pas compte de la réalité des uns et des autres», appuie Roger. «Du reste, depuis 2019, je n’ai vu ici aucun représentant des autorités qui nous mette des bâtons dans les roues.» A quelques kilomètres de la vallée où l’on produisait, là aussi, son absinthe «pour les amis», son combat semble s’inscrire dans l’exacte continuité de ceux du Val-de-Travers. Mais cette fois, la solution ne prendra peut-être pas des décennies pour montrer le bout de son nez, comme dans le cas de la fée verte. «Le département a connaissance des difficultés rencontrées par les établissements de l’hôtellerie-restauration», rassure Denis Pittet, «notamment dans le contexte que nous connaissons, marqué par deux années de pandémie et une situation internationale complexe. Le projet de révision du règlement d’exécution de la loi sur les auberges et les débits de boisson va ainsi dans le sens d’un allègement des exigences imposées aux restaurateurs.»
Niché dans sa cabane, Roger, de son côté, continue le combat. Récemment, il a adressé une demande de soutien à toutes les communes du canton. L’une d’entre elles, située dans un tout autre district, a déjà promis un don de mille francs. Les petites rivières font les grands menegetz, sans doute.