La voix muette
Rarement un auteur moderne ne s’est aventuré aussi loin dans les méandres de l’âme féminine et de la mémoire collective qu’avec Houris, le dernier roman de Kamel Daoud, couronné par le prix Goncourt en 2024. L’auteur ne s’est pas cantonné aux développements éblouissants déjà esquissés dans son précédent succès, Meursault, contre-enquête, mais voilà qu’il nous livre, en cette nouvelle fresque, un chant long et poignant qui mêle ardeur poétique et perspicacité anthropologique. Houris se lit d’un trait et vous happe d’emblée dans les tourbillons d’une Algérie palpitante, déchirée et, cependant, debout.
Une Algérie silencieuse et vibrante
De prime abord, Houris se déploie dans l’arrière-pays algérien où la nature, tantôt hostile, tantôt prodigue, donne aux personnages la mesure de leur fragilité. On y sent le souffle chaud du désert, la dureté minérale des montagnes, mais aussi la sourde clameur des souvenirs d’un conflit fratricide, la décennie noire, dont la plaie, à peine cicatrisée, saigne encore au moindre frôlement.
Kamel Daoud n’est pas homme à céder à la facilité de la simple fresque historique qui est à la littérature ce que la restauration rapide est à la gastronomie. Chaque paysage est un miroir tendu à l’âme du lecteur, chaque pierre semble avoir un nom, chaque caillou raconte une histoire. L’horizon, qui pourrait se confondre avec un décor vide, se peuple de silhouettes, d’ombres et de songes : ceux des victimes anonymes, de leurs descendants et, bien sûr, de ceux qui ont tenté de conjurer l’oubli.
Aube, la porteuse de voix muette
Au cœur du récit, une héroïne hors du commun : Aube, jeune coiffeuse dans la ville d’Oran qui se remet à peine de ses blessures. Elle porte dans sa chair la marque violente de la guerre civile : une longue cicatrice à la gorge, stigmate d’un massacre dont elle fut l’unique survivante, lui ôtant l’usage de la parole. La parole qu’on lui a confisquée, elle la retrouve par la pensée, par l’écriture et l’imagination. Enceinte, elle parle intérieurement à sa fille à naître, la « petite Houri » dont le nom symbolique parcourt le roman tel un refrain.
Il se dégage de cette figure d’Aube une force autant héroïque que tragique. Muette, elle est pourtant l’âme sonore du récit. Jamais je n’ai vu une telle antinomie se déployer avec un naturel aussi souverain. L’auteur lui fait porter un océan de questionnements : le poids du passé, l’héritage familial et religieux, le rôle de la femme dans un pays laminé par la terreur. Chaque page semble bruire du dialogue intime qu’Aube entretient avec son enfant à venir : cette parole intérieure, tellement dense, nous envoûte et nous confère le sentiment d’écouter une voix inspirée.
Une quête initiatique
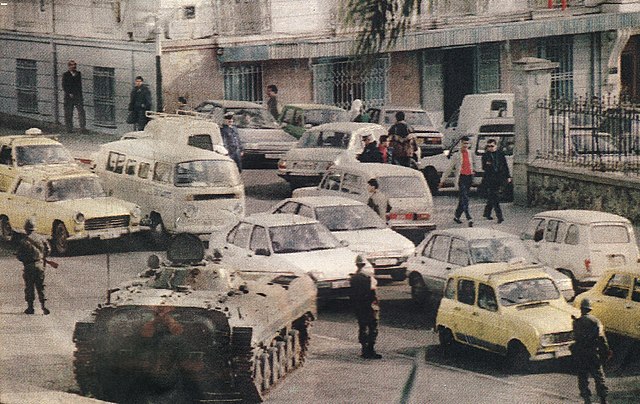
Parce que la cicatrice est plus qu’un signe, parce qu’elle réclame réparation ou, du moins, reconnaissance, Aube entreprend un voyage vers son village natal. Cette quête n’a rien de léger : c’est une descente vers la mémoire interdite, un rappel constant des fantômes dont l’Algérie contemporaine essaie si maladroitement de se délester. L’héroïne y est accompagnée d’un chauffeur-libraire, personnage pittoresque et discret, comme un Virgile qui la guide à travers ce purgatoire des souvenirs.
Aux abords des routes, dans les cafés, ou devant les maisons en ruine, la vie algérienne se révèle alors dans toute sa complexité. Le chauffeur est-il un simple conducteur ou une conscience critique ? Est-il ce témoin indispensable, ce passeur d’histoires, ou le miroir dans lequel Aube se voit reconstituer son propre passé ? L’ambiguïté est savamment entretenue, et de ce fait, le récit s’inscrit dans une tradition littéraire qui allie le réalisme à la fable philosophique.
La mémoire collective et le silence imposé
L’une des forces cardinales de Houris réside dans l’exploration de cette mémoire collective, objet d’une censure tacite : la décennie noire, si peu nommée, si peu commémorée, demeure comme un secret de famille que l’on préfère recouvrir d’un voile pudique. Pourtant, Kamel Daoud avance avec courage dans l’élucidation de ce traumatisme national. Il met en scène des personnages que l’on croirait rencontrés au détour d’une rue : des familles qui ont perdu leurs proches, des militants éreintés, des notables qui composent avec le mensonge d’État, et des jeunes gens pour qui tout ce passé ne semble qu’une rumeur lointaine.
D’une plume précise, Daoud dévoile les injonctions d’oubli, de même que les rancœurs accumulées. Les morts sans sépulture, les bourreaux reconvertis en citoyens ordinaires, les survivants qui demeurent marqués au fer rouge : tout cela forme un tableau d’une intensité stupéfiante. On y perçoit les abîmes de l’âme, l’insondable fragilité des institutions et la soif d’apaisement d’un peuple.
Une langue charnelle et méditative
On serait tenté de comparer le style de Daoud à celui d’un Camus, tant l’Algérie semble vibrer dans chaque phrase. Pourtant, il s’en écarte par une profondeur spirituelle. Jamais emphatique, la prose s’autorise parfois des élans poétiques : ces levers de soleil qui transfigurent le décor, ces chapitres entiers qui semblent chanter plutôt que décrire. Les dialogues, rares, résonnent telle une partition musicale : ils émaillent le silence et le subliment.
Le lecteur est ainsi emporté dans un flot d’images, tantôt lumineuses, tantôt sombres, qui évoquent l’oppressante beauté d’un pays en pleine métamorphose. Au fil de ces pages, se dessine un style unique, où le lexique à la fois quotidien et métaphorique nous prend par la main pour nous faire côtoyer l’ineffable. La violence de la guerre s’invite par éclairs, sans jamais sombrer dans un réalisme sinistre. L’auteur nous préserve de la complaisance dans l’horreur, préférant la suggestion à l’exposé clinique.
Un Goncourt mérité
Nul ne s’étonne que Houris ait reçu le prix Goncourt de 2024. L’œuvre, d’une densité rare, vient combler un vide dans la littérature francophone. Elle y apporte un éclairage singulier sur l’Algérie post-guerre civile, soulignant que la douleur n’est pas l’apanage des victimes, mais un fardeau collectif auquel chaque lecteur peut s’identifier.